Après l’évaluation statistique de la répression judiciaire militaire de 1914 à 1916, Prisme poursuit l’étude entreprise en prenant en compte les mêmes données pour déterminer ce qu’il est advenu des condamnés à mort, fusillés dans la foulée, ou bien après retour de la demande de grâces, de ceux voués à la prison, aux travaux publics ou au poteau d’exécution quand la demande faite en leur faveur a été rejetée.
En parallèle, se fait un suivi de l’évolution d’une autre population, qui en première instance a été condamnée à mort en l’absence des inculpés, car supposés être passés à l’ennemi, et de ce fait, condamnés à mort par contumace. Cette étude comparative va se faire année après année de 1914 à 1919. Nous poursuivons ici avec l’année 1917, l’année des « mutineries », en conseillant de (re)lire au préalable les études précédentes.
Nota : toutes les captures d’images non sourcées présentées dans cet article sont issues de MDH/SHD Dossiers fusillés, les autres documents sont sourcés.
Présentation quantitative des différentes populations de condamnés à mort en 1917
Comme pour les trois années précédentes, nous commençons par évoquer les condamnés à mort de trois populations que nous avons exclues de nos séries statistiques :
1-les soldats allemands,
2-les civils,
3-les militaires jugés hors zone du front :
-dans les régions militaires de métropole,
-dans les régions militaires de métropole,
-en Algérie
-au Conseil de Guerre de Tunis.
1-Soldats allemands : 0
En 1917, il n’y a eu aucune condamnation à mort de soldats allemands. Rappel : en 1914 : 17, en 1915 : 6 et en 1916 : 1
2-Civils : 71
Il est rappelé qu’on est passé de 31 condamnations en 1914 à 32 en 1915 puis 26 en 1916. En 1917, on en totalise 71.
Comment expliquer ce doublement par rapport à 1916 ? Il a pour origine l’Algérie et les Balkans.
Pour l’Algérie : condamnés à mort : 17, exécutés : 15 ; décédés avant exécution : 2, graciés : 0.
En Algérie, les condamnés à mort le sont soit pour banditisme traditionnel, soit pour participation collective à des violences et des pillages. La majorité des condamnés à mort l’ont été au cours de deux sessions de Conseil de Guerre, dans la dernière semaine d’août, l’une à Alger, l’autre à Constantine.
A Alger, le procès s’était terminé par 8 condamnations à mort dont 2 par contumace et 6 exécutions, dont une obtenue après capture d’un des deux contumaces, avec toujours les mêmes motifs : assassinat et vols. La majorité des condamnés (6 sur 8) l’ont été le 29 août lors du jugement groupé de 18 prévenus dont 2 en cavale. Tous appartenaient à 3 bandes, constituées fin 1914 aux environs de Ténès, à partir de 3 déserteurs du 9e Régiment de Tirailleurs et de résidents des douars environnants. Armés, dit le rapporteur, ils « ont fait régner la terreur » parmi la population autochtone et inquiétant les colons, commettant meurtres, tentatives de meurtre, vols dont le nombre a été évalué à 123. Le 25 novembre 1916, ils ont pris sous leurs feux 2 gendarmes, les tuant et les dépouillant de leurs armes et biens personnels. Treize parmi les 18 prévenus, dont 16 présents à l’audience, étaient solidairement accusés de participation à ces deux assassinats, les autres de recel et complicité. Au bilan, 8 étaient condamnés à mort dont deux par contumace, le déserteur chef d’une bande Belouaid Abdelkader ben Louaid, et Nourine dit El Kébir ben Heddi, d’une autre bande qui avaient échappé au coup de filet. S’ajoutaient 4 acquittés, 3 aux travaux forcés à perpétuité, 2 à 20 ans de travaux forcés et 3 autres à 10 ans de prison. Le dossier indique que Saad Saoud, un des condamnés à perpétuité, n’a eu une remise du restant de sa peine que par un décret du 20 août 1947. Pour les 4 condamnés à mort aux mains de la Justice, après rejet de révision, rejet de cassation et rejet de grâce, 3 d’entre eux étaient passés par les armes sur le champ de tir de Ténès le 19 février 1918, soit près de 6 mois après la sentence. Le quatrième était à cette date déjà mort en prison. Quant au chef Belouaïd, capturé près de Taza en 1919 au sein d’un groupe d’irréguliers marocains en lutte contre l’armée française, il était jugé le 18 juin 1919 et exécuté le 28 février 1921, sa désertion à l’ennemi et son port des armes contre la France, ayant été ajoutés à ses motifs d’inculpation initiaux, lors d’un ultime jugement à Taza le 18 décembre 1920. Stricto sensu, ces 3 bandes se composaient de déserteurs enfuis dès leur incorporation, d’insoumis et de civils. Prisme a décidé de les comptabiliser comme civils.
Au Conseil de Guerre de Constantine, il s’agissait de juger une flambée de violence survenue en novembre 1916 dans les Aurès, suite à un décret du 7 septembre qui permettait d’incorporer comme conscrits la totalité des classes algériennes. Jusque-là la conscription n’avait servi que pour compléter les régiments de tirailleurs. Le prélèvement avait été en moyenne en 14 et 15 de 2500, soit un incorporable sur 16. Le remplacement moyennant finance permettait encore de limiter la contrainte pour ceux qui pouvaient payer. Mais déjà en août, on avait incorporé 4800 jeunes de la classe 1916 au lieu des 2500 de la classe précédente, et en fonction du décret du 7 septembre avait été entrepris le recensement de la classe 1917 pour une incorporation en décembre. Parallèlement, en fonction d’un décret du 14 septembre, on procédait à l’embauche, quand c’était possible, sinon à la réquisition quand on manquait de volontaires, de 15 000 travailleurs réclamés pour les usines d’armement en métropole. Ce brutal accroissement de prélèvement de la ressource en jeunes hommes avait provoqué une irritation profonde, qui se manifestait quand l’administration venait sur place procéder au Conseil de révision. Le 11 novembre, cette opération avait lieu dans la commune de Mac Mahon, sous la présidence du sous-préfet de Batna, M. Cassinelli.
Selon le rapport envoyé au gouvernement « Dans la nuit du 11 au 12, un millier d’indigènes du douar Aouf se portent sur Mac Mahon, envahissent le bordj, incendient les appartements, font feu sur M. Cassinelli, sur M. Marseille, administrateur et sur l’une de ses filles, pillent le village, coupent la voie ferrée et la ligne télégraphique. M. Marseille est tué sur le coup et son enfant grièvement blessée. M. Cassinelli est mort des suites de ses blessures. Les émeutiers sont alors dispersés par les Zouaves du peloton de protection, au prix de 12 tués »
Au petit matin du 12, à 9 kilomètres de là, les quelques Européens présents autour de la maison forestière des Tamarins, implantée près du carrefour de la route Biskra-Batna et de la voie ferrée, découvraient un attroupement inhabituel « d’indigènes » suivi de l’envahissement par force de leurs demeures. « Dans la même nuit du 11 au 12 novembre, aux Tamarins, la gare était pillée et un garde forestier tué ».
Le 29 août 1917 comparaissaient 20 accusés pour « avoir participé à une entente établie avec la résolution d’agir dans le but de commettre des crimes contre les personnes et les propriétés courant novembre ».
Au bilan, donc, un garde-forestier, M. Terrazano avait été abattu par traîtrise. Blessé, il avait été achevé par un petit groupe qui s’était acharné sur lui. Les trois femmes présentes avaient été brutalisées, dévalisées, tandis que le dépôt de la voie ferrée était pillé.
C’est ainsi qu’avaient débuté ce qui fut appelé « Les troubles du Sud-Constantinois », entraînant pour la répression, l’engagement progressif sur 6 mois de près de 8 000 hommes de troupe, et l’envoi en renfort d’une brigade d’infanterie retirée du front : 72e et 91e RI, pour prêter main-forte aux opérations, menées avec appui d’artillerie et d’aviation, avec consignes de fusiller tout « indigène » porteur d’une arme. L’historien Gilbert Meynier ( p 583 in Gilbert Meynier, L’Algérie révélée, La guerre de 1914-1918 et le premier quart du XXe siècle, Editions Bouchène, St Denis, 2015, 789 pages) estime que, sur 5 mois, de 18 à 38 Européens et de 200 à 300 « indigènes » y perdirent la vie. Il ajoute : « Plusieurs centaines de personnes sont parquées en plein hiver dans un camp sans abri à Corneille ; beaucoup meurent à la prison de Constantine et à celle de Batna. Sur 147 prisonniers du Sud-Constantinois transférés à Taadmit, une centaine meurent du typhus » (p 584).
Les Conseils de guerre de Constantine et de Batna jugèrent respectivement 192 et 45 « émeutiers ». Celui de Constantine prononça une seule condamnation à mort pour Mac Mahon : Mohammed Ben Noui alias « Zerguini » et 7 pour l’affaire des « Tamarins ». Parmi eux 5 membres d’une même famille : les Hamaza. Le 12 décembre 1917, plus d’un an après l’insurrection, 6 d’entre eux étaient exécutés, le septième, de la famille Hamaza, s’étant pendu dans sa cellule préalablement le 1er novembre 1917. Pour valeur d’exemple, les 7 exécutions ont eu lieu précisément à Mac Mahon.
C’est cette volonté d’exemplarité qui, de même, avait entraîné l’exécution à Bordj-Menaiel, au cœur de la région qu’ils avaient écumée en 1914-1915, de 3 bandits kabyles : Ammouche, Hammoun, Benchelaghem, du douar Tchender.
Pour l’Orient : Condamnations à mort : 43, Exécutions : 41
En 1917, en Orient, la répression envers les civils autochtones, rude en 1916, a maintenu le caractère expéditif, pratiqué en France en 1914-1915 où il avait été atténué fortement depuis la loi du 27 avril 1916.
Il est de fait, que sur ce théâtre d’opérations, la situation est bien particulière. Ce qu’a écrit, à ce sujet Prisme pour la justice en 1916, est donc toujours d’actualité :
En Orient, le contexte est très différent. L’armée s’est implantée fin 1915 à Salonique, territoire d’un pays neutre, la Grèce. Cette région est un chaudron d’intrigues. La dernière guerre balkanique en 1913 s’est conclue par des modifications de frontières qui ont été loin de s’adapter à la mosaïque ethnique de la région, puisque résultant de la loi du plus fort du moment. Les communautés minoritaires, inquiètes, insatisfaites, espèrent qu’une nouvelle guerre leur permettra de réintégrer leur « mère patrie » rêvée : Bulgarie, Serbie, Albanie, empire ottoman ». Sur des fronts d’occupation bien moins densément occupés qu’en France, la circulation, dans ces pays de contrebandiers, est facile, et les autochtones en attente de modification du statu quo à leur profit, essaient de jouer des français, des bulgares et autrichiens, pour arriver à leurs fins. Aussi l’Armée française, opérant au sein d’une population dont elle n’attend aucune loyauté, a mis très tôt en place un réseau de commissaires de police pour assurer la sécurité du corps expéditionnaire. Il n’y a pas d’attaques délibérées contre la troupe, mais l’arrière-pays est parcouru de bandes s’adonnant à tous les trafics et s’attaquant aussi aux soldats isolés, en avançant parfois des motifs patriotiques : les comitadjis. Cette lutte va être âpre, sans merci, et on en voit trace au sein de la Justice militaire.
En 1916 cela s’était traduit par la condamnation à mort d’un turc, d’un gendarme albanais, exécutés à Florina et de 5 civils à Monastir entre le 3 et 19 décembre. Il est à noter qu’en 1916 et 1917, les exécutions se passent quasiment toutes sur les confins des territoires qui appartiennent aujourd’hui à la République de Macédoine et à l’Albanie. Sur ces régions régnaient (règnent encore ?) des tensions ethnico-confessionnelles, génératrices de violences. Bulgares et Serbes, sans compter les Grecs de confession orthodoxe, y étaient fermement décidés à se disputer la région et à l’absorber à leur profit au départ des troupes de l’Entente. Au milieu, les Albanais musulmans rêvaient de s’imposer afin de se donner une patrie taillée dans les ambitions des deux autres protagonistes. Le conflit et son cortège de violences préexistait à l’arrivée des troupes françaises. La lutte franco-germano-austro-hongroise n’était pas celle des populations. Les ressortissants serbes appuyaient les Français, contrairement aux bulgarophiles. Quant aux Albanais, pour arriver à leurs fins, ils jouaient des deux camps au mieux de leurs intérêts. Pour cela ils disposaient de bandes armées irrégulières qui, officiellement alliées à l’un ou l’autre camp, se préoccupaient surtout d’expulser tous les protagonistes extérieurs et de soumettre les autochtones non-albanais. On se battait peu sur ce front bizarre, chaque camp se servant des habitants locaux pour espionner la partie adverse et traquer les espions infiltrés sur ses arrières. La guerre se faisait par « supplétifs interposés» qui régnaient dans le no man’s-land, supplétifs dont le seul loyalisme allait à leur projet politique pour l’après-guerre. C’était donc une guerre « sale », du style des guerres de décolonisation du XXe siècle, avec un double jeu permanent et une cruauté pour s’imposer. Pour privilégier ce type d’action à la place d’offensive de ses troupes, le général Sarrail, « Commandant des armées alliées », était voué aux gémonies par le GQG qui l’accusait de faire seulement, et sans autorisation, de la politique. A Korytza, ainsi, ce reproche semblait mérité :
« Le territoire de Korytza (Albanie) était commandé par un officier de cavalerie (d'Afrique), le colonel Descoins. Descoins menait à Korytza une existence de satrape. Il avait un Konak, un harem, une garde indigène, un drapeau spécial à la hampe duquel pendaient des queues de cheval. Il émettait des timbres spéciaux (avec fautes et erreurs volontaires) dont le commerce fut assez florissant pour lui.
Descoins avait comme pourvoyeur-entremetteur et conseiller militaire un certain Thémistokli, nommé par lui, Préfet de Police de Korytza à qui, un jour, en grande pompe, toute la population étant réunie sur la place, il remit personnellement la croix de guerre afin de le récompenser de ses bons, de ses très bons offices. (source : lettre adressée après-guerre à l’ancien rédacteur du communiqué du GQG, devenu journaliste, Fonds privé Jean de Pierrefeu, SHD, 1K 120)
Ce Thémistokli avait quitté le service des Bulgaro-Autrichiens en décembre 1916, avec sa bande dont les membres avaient été titularisés gendarmes albanais, toujours aux ordres de leur chef, pour assurer l’ordre dans une population bigarrée, lourde d’hostilité entre communautés aux aspirations différentes. A la guerre militaire s’adjoignait une guerre civile avec ses combattants sans uniforme, mais armés par peur des voisins. Descoins et Themistokli s’étaient mis d’accord sur le fait que dans le canton de Korytsa, était reconnu le fait que la population était majoritairement albanaise et qu’elle pouvait revendiquer une telle nationalité sous protection française. Cet accord avait hérissé le service d’espionnage français, persuadé que Themistokli, jouait double jeu, en renseignant la bande albanaise adverse de Sali Boutka.
En se méfiant de la description de Sarrail, certainement un peu chargée, il semble que les méthodes expéditives en vigueur dans la région avant l’arrivée des troupes françaises, aient été avalisées par lui :
« C'est un militaire dans toute la force du terme, un militaire violent, cassant, volontiers grossier, jouissant ingénument de son autorité, en abusant, n'admettant aucun avis, aucune remontrance, en se croyant grand politique. [..]
Ce général républicain est un Galliffet. Le nombre des Macédoniens, des Grecs, des Juifs, des Turcs et des Albanais qu'il a fait fusiller sans jugement, pour des peccadilles est considérable. Par ses soins diligents, les camps de concentration de Zeitenlick et de Mithylene regorgeaient de gens. On y mettait des vieillards, des enfants et on les y oubliait. Sarrail paraissait éprouver une sorte de jouissance à y envoyer des notables (députés, maires, anciens ministres etc.), des religieux (popes, muftis, rabbins).
Et ces hommes souvent âgés, arrachés de chez eux, logeaient sous la tente, cassaient des cailloux, creusaient des canaux d'irrigation » (même source que plus haut)
Les dossiers de Justice militaire montrent qu’il donnait l’ordre d’exécution sans attendre la réponse du Conseil de révision, quand celui-ci était saisi par les condamnés. Ce fut le cas de 6 fusillés de février à avril.
Cette façon de s’asseoir sur les droits des prévenus ne s’appuyait sur aucune décision écrite de sa part. La circulaire ministérielle du 20 avril 1917, signée Painlevé, dont nous reparlerons plus avant, pour ses conséquences pour les condamnés à mort, l’obligea à donner toutefois, explicitement, des consignes claires. Que disait cette circulaire qui s’adressait au général en chef, exécutoire sur tous les théâtres d’opération ? :
« Lorsqu’un jugement prononçant la peine de mort sera devenu définitif, du fait que le condamné n’aura pas formé de recours en révision, ou que ce recours et le cas échéant le pourvoi en cassation auront été rejetés, le dossier de la procédure devra toujours m’être transmis, avec l’avis des autorités hiérarchiques et le vôtre sur l’opportunité de laisser ou non la Justice suivre son cours »
Ce texte clair, abrogeait la latitude du commandement et des juges à décider ou non d’un recours en grâce auprès du Président de la République. Le politique, par le biais du Ministre de la Guerre prenait en charge, à partir de cette date, la responsabilité d’ordonner exclusivement les exécutions parmi les condamnés à mort par la justice militaire.
A la lecture de ce texte le général Sarrail, commandant des armées alliées d’Orient, chargé de son application, l’avait répercuté dès le lendemain, mais en y ajoutant une nuance de taille, pour l’Armée Française d’Orient :
« Télégramme du 21 avril 1917 N° 2286/2M :
Donner ordres pour que dorénavant les condamnations à mort pour turcs, bulgares, grecs, etc. soient immédiatement suivies d’exécution. Seuls les soldats français doivent, avant d’être fusillés, avoir leur cas soumis au Conseil de Révision et appel au Président de la République »
Si en mai et juin ne sont respectivement fusillés qu’un turc et un grec, en respectant ce dispositif expéditif, le 23 août, un réseau d’Albanais, jugé par le Conseil de Guerre de la 57e DI, aboutissait à 12 condamnations à mort et à l’exécution de 10 d’entre eux le 25.
Avant de faire de même, sur requête de son commissaire rapporteur, le général de Vassart, commandant la 76e DI, avait demandé toutefois, le 25 août, la confirmation de cette règle de conduite concernant les prescriptions de la circulaire qui avaient été amendées entre le 11 juin et le 14 juillet pour faire face aux mutineries. Après cette date, les prescriptions de la circulaire ministérielle « Painlevé » du 20 avril 1917, s’appliquaient pleinement.
Le 29 août, le général Grossetti, commandant l’Armée Française d’Orient, répondait :
« Le recours en grâce ne s’applique qu’aux militaires français, aux militaires étrangers servant dans les régiments étrangers et aux indigènes incorporés sous le drapeau français. Quant aux condamnés grecs, turcs et bulgares, rien n’est changé aux dispositions prévues par la note du 20 avril 1917 du Cdt des Armées Alliées notifiée le 21 sous le N° 2286M/2M par l’Armée Française d’Orient.
En foi de quoi le général publiait la Note suivante :
Qu’avait-il été reproché à ce pope-cultivateur du village de Piskupige en Serbie ? En vue d’assurer la sécurité sur les arrières de l’Armée Française d’Orient, obligation avait été faite aux civils de remettre leurs armes à feu, sous la menace dissuasive de la note N° 5009/2 SR du 5 mai 1917 qui stipulait que tout détenteur d’armes non remises serait fusillé sur le champ. C’est ainsi que 5 habitants de Piskupige, trouvés possesseurs chacun d’un fusil Mauser, avaient été fusillés sur place. Auparavant le Commissaire de Police Benoist, Chef du Service de Sûreté de l’A.F.O, était venu s’enquérir des raisons du non-respect de la requête de venir déposer ses armes à la mairie. Ils répondaient qu’ils avaient obéi aux conseils du pope qui les avait encouragés à garder dissimulées leurs armes. Arrêté, accusé d’avoir fréquemment, en soirée, allumé du feu visible des lignes adverses, contrevenant au couvre-feu, d’avoir laissé partir son fils avec les troupes bulgares, lors du retrait de celles-ci, il était passé en jugement le 10 septembre et exécuté le lendemain au monastère de Kristofor près de Bukovo.
Tous ces acteurs autochtones s’appuyaient sur des réseaux. Condamné à mort le 10 avril, le turc Osman Balkalabatchich, avait cru alors échapper au poteau en livrant la bande avec qui il avait partie liée. Son espoir avait été déçu, car on a vu qu’il était exécuté le 21 avril. Ses révélations avaient permis la condamnation à mort des 12 du 23 août. Deux avaient échappé à l’exécution Adem Békir et Kerin Biniako. Ils avaient particulièrement intéressé le Commissaire Benoist car leurs révélations allaient pouvoir lui permettre de confondre sa bête noire : Themistokli.
Kerin Biniako, lieutenant de cette gendarmerie albanaise, Adem Békir, négociant, racontèrent au commissaire le premier qu’il avait assisté à une rencontre entre Sali Boutka et Themistokli, où ce dernier lui avait conseillé de rester avec les Bulgares, et le second qu’il avait servi de facteur pour transmettre les courriers de Themistokli aux responsables de l’espionnage germano-bulgares.
Avec ces preuves, l’arrestation était décidée, tandis que les deux qui avaient parlé, échappaient au poteau. Arrêté le 1er novembre, Themistokli était jugé le 7 novembre par le Conseil de Guerre de Salonique. Malgré une défense pied à pied, plaidant son patriotisme albanais, celui qui avait fait la pluie et le beau temps à Korytza de décembre 1916 à fin octobre 1917, décoré de la Croix de Guerre, était condamné à mort.
Le Commissaire-rapporteur arrêtait alors le dossier en concluant ainsi : « Jugement exécutoire après expiration des délais de révision et l’exercice du droit de grâce – Décret 9 juin 1916 et Circulaire ministérielle du 20 avril 1917 »
Le lendemain 8 novembre, Themistokli, dans les délais, se pourvoyait en révision.
Mais, à la surprise du Commissaire-Rapporteur, le processus était rapidement stoppé :
La pièce officielle relatant la décision prise par le Conseil de révision, fait apparaître la brusque interruption de la procédure.
L’exécution de Themistokli marquait un terme à la traque de ce groupe albano-musulman.
Le 26 novembre 1917, une autre longue enquête de notre Commissaire de Police Benoist livrait au Conseil de Guerre de la 76e DI un réseau d’espions, cette fois-ci au profit de la Bulgarie, tous condamnés à mort à l’issue du procès. Le général de Vassart n’a pas demandé cette fois confirmation de l’exécution immédiate, et l’a ordonnée pour le lendemain 27 novembre, à grand spectacle, près de la petite bourgade serbe de Holeven, la population tenue à distance, assistant à la fusillade, à 6h30, des 18 condamnés à mort, record des exécutions collectives par l’armée française dans la grande guerre.
Venue pour tendre la main aux serbes et combattre allemands, autrichiens et bulgares, l’armée française s’enfonçait dans la lutte sans merci contre des guérillas provoquées par la complexité des situations ethnico-politiques, les réprimant avec brutalité.
En métropole, on condamne en 1917 des civils : 10 en arrière et un en zone des armées. A l’arrière, 8 le sont pour espionnage ; tous étrangers : 3 espagnols, deux roumains, un mexicain, un néerlandais, un allemand ; ils ont tous été fusillés, le Président de la République ayant systématiquement refusé la grâce. Mata Hari et Bolo Pacha sont à ajouter à cette liste de 1917.
Un seul civil, Kalsch est condamné pour ce motif dans la zone des Armées pour des faits remontant à août 1914 en Lorraine. Les deux derniers le sont pour assassinat. Contrairement aux espions, ils ne sont pas exécutés, leur peine commuée en travaux forcés à perpétuité.
3-Les militaires condamnés puis exécutés dans les Conseils de Guerre permanents hors zone des Armées : 9
En métropole, il s’agit de 4 inculpés de trahison : Colnion, Bulme, Sideney, Capitaine Estève et de 4 assassins : Buttard, Margottin, Minangouin et Terrier. En Algérie, il s'agit de Mamou Ouali ben Yahia condamné pour meurtre.
Il faut rappeler que ces Conseils de Guerre disposent de 7 juges et que leurs Conseils de révision disposent de deux magistrats civils dont l’un d’eux est Président de droit. Le pourvoi en révision y existe depuis janvier 1915. Les 8 ont eu leur demande de grâce rejetée.
Hors Conseils de Guerre, deux autres militaires ont été jugés par des juridictions civiles et ont fini sur l’échafaud.
4-Les militaires condamnés par les Conseils de Guerre dans la zone des Armées
A-Evolution des différentes populations de condamnés à mort en 1917
Ne sont comptabilisés ici que les condamnés à mort sur le front Nord/Est, d’Orient, en Tunisie du Sud et au Maroc : territoires sur lesquels s’exerce, jusqu’en avril 1917, l’exceptionnalité de la demande de grâce.
Commençons par les bilans statistiques :
Pour information, aucune des données présentes dans ce tableau n’a été arrangée pour obtenir des calculs justes. Tous ces chiffres sont la traduction quantitative dans des tableaux mensuels de tous les noms des militaires condamnés à mort connus du Prisme.
Nota : dans le tableau ci-dessus, à partir du mois de mai, les conditions ayant changé, le pourcentage de grâces demandées n’a plus de raison d’être, les cases sont donc grisées. Le soldat Denison a été compté parmi les condamnés à mort/fusillés. Le soldat Moulia a été seulement compté parmi les condamnés à mort.
Que peut-on dire de global à la consultation de ce tableau ?
-Un record annuel du nombre de condamnations à mort :
1914 pour 4 mois : 209 ; 1915 : 461 ; 1916 : 380 ; 1917 : 671
-Un pic de condamnations à mort concentré de juin à octobre et d’exécutions sur juin.
-Une continuation du déclin du nombre d’exécutés :
1914 : 155 ; 1915 : 297 ; 1916 : 125 ; 1917 : 80
-Un taux de refus de grâce, non négligeable en début d’année, en voie ensuite de décroissance en fin d’année, portant le total d’exécutés avec autorisation du pouvoir politique à 64.
-Peu de cassations pour vices de forme en général, sauf en janvier, juin, juillet et août.
-Une intervention politique majeure : la circulaire ministérielle du 20 avril 1917 (présentée dans la sous-partie des condamnés en Orient).
Le tableau peut déconcerter par sa complexité. En fait, il permet d’avoir une vue globale. Par rapport à l’année 1916, qui a introduit le pourvoi en révision à l’initiative du condamné à mort par le décret du 8 juin, 1917 se caractérise par la mise en œuvre, à partir du 20 avril, de l’interdiction d’exécution de tout condamné à mort par un Conseil de Guerre sans autorisation du pouvoir politique.
On rappelle ici ce que dit cette nouvelle circulaire :
« Lorsqu’un jugement prononçant la peine de mort sera devenu définitif, du fait que le condamné n’aura pas formé de recours en révision, ou que ce recours et le cas échéant le pourvoi en cassation auront été rejetés, le dossier de la procédure devra toujours m’être transmis, avec l’avis des autorités hiérarchiques et le vôtre sur l’opportunité de laisser ou non la Justice suivre son cours »
Cette circulaire Painlevé abroge celle de son prédécesseur Millerand du 1er septembre 1914 rappelée ici :
« Dès qu'une condamnation capitale, prononcée par un Conseil de Guerre sera devenue définitive soit qu'elle n'ait pas été attaquée devant le Conseil de Révision, soit que le recours, ou le cas échéant le pourvoi en cassation ait été rejeté, soit enfin qu'il s'agisse de condamnation prononcée par un des Conseils de Guerre aux armées à l’égard desquels le décret du 10 août 1914 a suspendu le recours en révision, l'officier qui a ordonné la mise en jugement prendra immédiatement les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement à moins qu'exceptionnellement il n'estime qu'il y a lieu de proposer au Chef de l’Etat une commutation de peine »
C‘est un changement dans la lettre et dans l’esprit. Le soldat-citoyen ne peut plus être exécuté qu’avec l’aval présidentiel. L’autorité militaire, par sa justice, garde le pouvoir de condamner à mort, mais plus celui d’exécuter.
Jusque-là, les dossiers des condamnés à mort n’étaient adressés à la Direction du Contentieux et de la Justice militaire au Ministère de la Guerre que si le général de division ou un ou plusieurs juges sollicitaient une commutation de peine.
A partir du décret du 8 juin 1916, qui rétablissait le pourvoi en révision, le dossier, cette fois, avait commencé par transiter par le Conseil de révision, en cas de pourvoi par le condamné à mort.
L’accès à ce Conseil, ses modalités, lui étaient précisés par deux articles du Code de Justice Militaire :
-l’article 141 :
« Le Commissaire du gouvernement (rapporteur en temps de guerre) fait donner lecture du jugement à l’accusé par le greffier, en sa présence et devant la garde sous les armes.
Aussitôt après cette lecture, il avertit le condamné que la loi lui accorde vingt-quatre heures pour exercer son recours devant le conseil de révision.
Le greffier dresse du tout un procès-verbal signé par lui et le Commissaire du gouvernement »
-l’article 144 :
« Le délai de 24 heures accordé au condamné pour se pourvoir en révision court à partir de l’expiration du jour où le jugement lui a été lu.
La déclaration du recours est reçue par le greffier. La déclaration peut être faite par le défenseur de l’accusé »
Dans le cas où le jugement était annulé par ce Conseil, le dossier était transmis au Conseil de Guerre de la division qui allait avoir à juger à nouveau.
Sinon, si le Conseil n’avait pas trouvé de vices de forme, c’est le commissaire du Conseil qui faisait suivre le dossier sur Paris, si une demande de grâce avait été posée. Il le renvoyait au Conseil de Guerre qui avait jugé s’il n’y avait pas eu demande de grâce.
A partir de la circulaire du 20 avril, les circuits restaient les mêmes, à la différence que les commissaires-rapporteurs en Conseils de Guerre ou en Conseils de révision n‘avaient plus à se soucier de demandes de grâce ou pas, et pouvaient expédier, dès jugement fait, les dossiers revêtus des avis hiérarchiques sur Paris.
A l’armée la condamnation, au pouvoir politique la décision d’exécution.
Il est évident que la lettre du 20 avril est un texte de grande importance.
Pour l’Algérie : condamnés à mort : 17, exécutés : 15 ; décédés avant exécution : 2, graciés : 0.
En Algérie, les condamnés à mort le sont soit pour banditisme traditionnel, soit pour participation collective à des violences et des pillages. La majorité des condamnés à mort l’ont été au cours de deux sessions de Conseil de Guerre, dans la dernière semaine d’août, l’une à Alger, l’autre à Constantine.
A Alger, le procès s’était terminé par 8 condamnations à mort dont 2 par contumace et 6 exécutions, dont une obtenue après capture d’un des deux contumaces, avec toujours les mêmes motifs : assassinat et vols. La majorité des condamnés (6 sur 8) l’ont été le 29 août lors du jugement groupé de 18 prévenus dont 2 en cavale. Tous appartenaient à 3 bandes, constituées fin 1914 aux environs de Ténès, à partir de 3 déserteurs du 9e Régiment de Tirailleurs et de résidents des douars environnants. Armés, dit le rapporteur, ils « ont fait régner la terreur » parmi la population autochtone et inquiétant les colons, commettant meurtres, tentatives de meurtre, vols dont le nombre a été évalué à 123. Le 25 novembre 1916, ils ont pris sous leurs feux 2 gendarmes, les tuant et les dépouillant de leurs armes et biens personnels. Treize parmi les 18 prévenus, dont 16 présents à l’audience, étaient solidairement accusés de participation à ces deux assassinats, les autres de recel et complicité. Au bilan, 8 étaient condamnés à mort dont deux par contumace, le déserteur chef d’une bande Belouaid Abdelkader ben Louaid, et Nourine dit El Kébir ben Heddi, d’une autre bande qui avaient échappé au coup de filet. S’ajoutaient 4 acquittés, 3 aux travaux forcés à perpétuité, 2 à 20 ans de travaux forcés et 3 autres à 10 ans de prison. Le dossier indique que Saad Saoud, un des condamnés à perpétuité, n’a eu une remise du restant de sa peine que par un décret du 20 août 1947. Pour les 4 condamnés à mort aux mains de la Justice, après rejet de révision, rejet de cassation et rejet de grâce, 3 d’entre eux étaient passés par les armes sur le champ de tir de Ténès le 19 février 1918, soit près de 6 mois après la sentence. Le quatrième était à cette date déjà mort en prison. Quant au chef Belouaïd, capturé près de Taza en 1919 au sein d’un groupe d’irréguliers marocains en lutte contre l’armée française, il était jugé le 18 juin 1919 et exécuté le 28 février 1921, sa désertion à l’ennemi et son port des armes contre la France, ayant été ajoutés à ses motifs d’inculpation initiaux, lors d’un ultime jugement à Taza le 18 décembre 1920. Stricto sensu, ces 3 bandes se composaient de déserteurs enfuis dès leur incorporation, d’insoumis et de civils. Prisme a décidé de les comptabiliser comme civils.
Au Conseil de Guerre de Constantine, il s’agissait de juger une flambée de violence survenue en novembre 1916 dans les Aurès, suite à un décret du 7 septembre qui permettait d’incorporer comme conscrits la totalité des classes algériennes. Jusque-là la conscription n’avait servi que pour compléter les régiments de tirailleurs. Le prélèvement avait été en moyenne en 14 et 15 de 2500, soit un incorporable sur 16. Le remplacement moyennant finance permettait encore de limiter la contrainte pour ceux qui pouvaient payer. Mais déjà en août, on avait incorporé 4800 jeunes de la classe 1916 au lieu des 2500 de la classe précédente, et en fonction du décret du 7 septembre avait été entrepris le recensement de la classe 1917 pour une incorporation en décembre. Parallèlement, en fonction d’un décret du 14 septembre, on procédait à l’embauche, quand c’était possible, sinon à la réquisition quand on manquait de volontaires, de 15 000 travailleurs réclamés pour les usines d’armement en métropole. Ce brutal accroissement de prélèvement de la ressource en jeunes hommes avait provoqué une irritation profonde, qui se manifestait quand l’administration venait sur place procéder au Conseil de révision. Le 11 novembre, cette opération avait lieu dans la commune de Mac Mahon, sous la présidence du sous-préfet de Batna, M. Cassinelli.
Selon le rapport envoyé au gouvernement « Dans la nuit du 11 au 12, un millier d’indigènes du douar Aouf se portent sur Mac Mahon, envahissent le bordj, incendient les appartements, font feu sur M. Cassinelli, sur M. Marseille, administrateur et sur l’une de ses filles, pillent le village, coupent la voie ferrée et la ligne télégraphique. M. Marseille est tué sur le coup et son enfant grièvement blessée. M. Cassinelli est mort des suites de ses blessures. Les émeutiers sont alors dispersés par les Zouaves du peloton de protection, au prix de 12 tués »
Au petit matin du 12, à 9 kilomètres de là, les quelques Européens présents autour de la maison forestière des Tamarins, implantée près du carrefour de la route Biskra-Batna et de la voie ferrée, découvraient un attroupement inhabituel « d’indigènes » suivi de l’envahissement par force de leurs demeures. « Dans la même nuit du 11 au 12 novembre, aux Tamarins, la gare était pillée et un garde forestier tué ».
Le 29 août 1917 comparaissaient 20 accusés pour « avoir participé à une entente établie avec la résolution d’agir dans le but de commettre des crimes contre les personnes et les propriétés courant novembre ».
Au bilan, donc, un garde-forestier, M. Terrazano avait été abattu par traîtrise. Blessé, il avait été achevé par un petit groupe qui s’était acharné sur lui. Les trois femmes présentes avaient été brutalisées, dévalisées, tandis que le dépôt de la voie ferrée était pillé.
C’est ainsi qu’avaient débuté ce qui fut appelé « Les troubles du Sud-Constantinois », entraînant pour la répression, l’engagement progressif sur 6 mois de près de 8 000 hommes de troupe, et l’envoi en renfort d’une brigade d’infanterie retirée du front : 72e et 91e RI, pour prêter main-forte aux opérations, menées avec appui d’artillerie et d’aviation, avec consignes de fusiller tout « indigène » porteur d’une arme. L’historien Gilbert Meynier ( p 583 in Gilbert Meynier, L’Algérie révélée, La guerre de 1914-1918 et le premier quart du XXe siècle, Editions Bouchène, St Denis, 2015, 789 pages) estime que, sur 5 mois, de 18 à 38 Européens et de 200 à 300 « indigènes » y perdirent la vie. Il ajoute : « Plusieurs centaines de personnes sont parquées en plein hiver dans un camp sans abri à Corneille ; beaucoup meurent à la prison de Constantine et à celle de Batna. Sur 147 prisonniers du Sud-Constantinois transférés à Taadmit, une centaine meurent du typhus » (p 584).
Les Conseils de guerre de Constantine et de Batna jugèrent respectivement 192 et 45 « émeutiers ». Celui de Constantine prononça une seule condamnation à mort pour Mac Mahon : Mohammed Ben Noui alias « Zerguini » et 7 pour l’affaire des « Tamarins ». Parmi eux 5 membres d’une même famille : les Hamaza. Le 12 décembre 1917, plus d’un an après l’insurrection, 6 d’entre eux étaient exécutés, le septième, de la famille Hamaza, s’étant pendu dans sa cellule préalablement le 1er novembre 1917. Pour valeur d’exemple, les 7 exécutions ont eu lieu précisément à Mac Mahon.
C’est cette volonté d’exemplarité qui, de même, avait entraîné l’exécution à Bordj-Menaiel, au cœur de la région qu’ils avaient écumée en 1914-1915, de 3 bandits kabyles : Ammouche, Hammoun, Benchelaghem, du douar Tchender.
Pour l’Orient : Condamnations à mort : 43, Exécutions : 41
En 1917, en Orient, la répression envers les civils autochtones, rude en 1916, a maintenu le caractère expéditif, pratiqué en France en 1914-1915 où il avait été atténué fortement depuis la loi du 27 avril 1916.
Il est de fait, que sur ce théâtre d’opérations, la situation est bien particulière. Ce qu’a écrit, à ce sujet Prisme pour la justice en 1916, est donc toujours d’actualité :
En Orient, le contexte est très différent. L’armée s’est implantée fin 1915 à Salonique, territoire d’un pays neutre, la Grèce. Cette région est un chaudron d’intrigues. La dernière guerre balkanique en 1913 s’est conclue par des modifications de frontières qui ont été loin de s’adapter à la mosaïque ethnique de la région, puisque résultant de la loi du plus fort du moment. Les communautés minoritaires, inquiètes, insatisfaites, espèrent qu’une nouvelle guerre leur permettra de réintégrer leur « mère patrie » rêvée : Bulgarie, Serbie, Albanie, empire ottoman ». Sur des fronts d’occupation bien moins densément occupés qu’en France, la circulation, dans ces pays de contrebandiers, est facile, et les autochtones en attente de modification du statu quo à leur profit, essaient de jouer des français, des bulgares et autrichiens, pour arriver à leurs fins. Aussi l’Armée française, opérant au sein d’une population dont elle n’attend aucune loyauté, a mis très tôt en place un réseau de commissaires de police pour assurer la sécurité du corps expéditionnaire. Il n’y a pas d’attaques délibérées contre la troupe, mais l’arrière-pays est parcouru de bandes s’adonnant à tous les trafics et s’attaquant aussi aux soldats isolés, en avançant parfois des motifs patriotiques : les comitadjis. Cette lutte va être âpre, sans merci, et on en voit trace au sein de la Justice militaire.
En 1916 cela s’était traduit par la condamnation à mort d’un turc, d’un gendarme albanais, exécutés à Florina et de 5 civils à Monastir entre le 3 et 19 décembre. Il est à noter qu’en 1916 et 1917, les exécutions se passent quasiment toutes sur les confins des territoires qui appartiennent aujourd’hui à la République de Macédoine et à l’Albanie. Sur ces régions régnaient (règnent encore ?) des tensions ethnico-confessionnelles, génératrices de violences. Bulgares et Serbes, sans compter les Grecs de confession orthodoxe, y étaient fermement décidés à se disputer la région et à l’absorber à leur profit au départ des troupes de l’Entente. Au milieu, les Albanais musulmans rêvaient de s’imposer afin de se donner une patrie taillée dans les ambitions des deux autres protagonistes. Le conflit et son cortège de violences préexistait à l’arrivée des troupes françaises. La lutte franco-germano-austro-hongroise n’était pas celle des populations. Les ressortissants serbes appuyaient les Français, contrairement aux bulgarophiles. Quant aux Albanais, pour arriver à leurs fins, ils jouaient des deux camps au mieux de leurs intérêts. Pour cela ils disposaient de bandes armées irrégulières qui, officiellement alliées à l’un ou l’autre camp, se préoccupaient surtout d’expulser tous les protagonistes extérieurs et de soumettre les autochtones non-albanais. On se battait peu sur ce front bizarre, chaque camp se servant des habitants locaux pour espionner la partie adverse et traquer les espions infiltrés sur ses arrières. La guerre se faisait par « supplétifs interposés» qui régnaient dans le no man’s-land, supplétifs dont le seul loyalisme allait à leur projet politique pour l’après-guerre. C’était donc une guerre « sale », du style des guerres de décolonisation du XXe siècle, avec un double jeu permanent et une cruauté pour s’imposer. Pour privilégier ce type d’action à la place d’offensive de ses troupes, le général Sarrail, « Commandant des armées alliées », était voué aux gémonies par le GQG qui l’accusait de faire seulement, et sans autorisation, de la politique. A Korytza, ainsi, ce reproche semblait mérité :
« Le territoire de Korytza (Albanie) était commandé par un officier de cavalerie (d'Afrique), le colonel Descoins. Descoins menait à Korytza une existence de satrape. Il avait un Konak, un harem, une garde indigène, un drapeau spécial à la hampe duquel pendaient des queues de cheval. Il émettait des timbres spéciaux (avec fautes et erreurs volontaires) dont le commerce fut assez florissant pour lui.
Descoins avait comme pourvoyeur-entremetteur et conseiller militaire un certain Thémistokli, nommé par lui, Préfet de Police de Korytza à qui, un jour, en grande pompe, toute la population étant réunie sur la place, il remit personnellement la croix de guerre afin de le récompenser de ses bons, de ses très bons offices. (source : lettre adressée après-guerre à l’ancien rédacteur du communiqué du GQG, devenu journaliste, Fonds privé Jean de Pierrefeu, SHD, 1K 120)
Ce Thémistokli avait quitté le service des Bulgaro-Autrichiens en décembre 1916, avec sa bande dont les membres avaient été titularisés gendarmes albanais, toujours aux ordres de leur chef, pour assurer l’ordre dans une population bigarrée, lourde d’hostilité entre communautés aux aspirations différentes. A la guerre militaire s’adjoignait une guerre civile avec ses combattants sans uniforme, mais armés par peur des voisins. Descoins et Themistokli s’étaient mis d’accord sur le fait que dans le canton de Korytsa, était reconnu le fait que la population était majoritairement albanaise et qu’elle pouvait revendiquer une telle nationalité sous protection française. Cet accord avait hérissé le service d’espionnage français, persuadé que Themistokli, jouait double jeu, en renseignant la bande albanaise adverse de Sali Boutka.
En se méfiant de la description de Sarrail, certainement un peu chargée, il semble que les méthodes expéditives en vigueur dans la région avant l’arrivée des troupes françaises, aient été avalisées par lui :
« C'est un militaire dans toute la force du terme, un militaire violent, cassant, volontiers grossier, jouissant ingénument de son autorité, en abusant, n'admettant aucun avis, aucune remontrance, en se croyant grand politique. [..]
Ce général républicain est un Galliffet. Le nombre des Macédoniens, des Grecs, des Juifs, des Turcs et des Albanais qu'il a fait fusiller sans jugement, pour des peccadilles est considérable. Par ses soins diligents, les camps de concentration de Zeitenlick et de Mithylene regorgeaient de gens. On y mettait des vieillards, des enfants et on les y oubliait. Sarrail paraissait éprouver une sorte de jouissance à y envoyer des notables (députés, maires, anciens ministres etc.), des religieux (popes, muftis, rabbins).
Et ces hommes souvent âgés, arrachés de chez eux, logeaient sous la tente, cassaient des cailloux, creusaient des canaux d'irrigation » (même source que plus haut)
Les dossiers de Justice militaire montrent qu’il donnait l’ordre d’exécution sans attendre la réponse du Conseil de révision, quand celui-ci était saisi par les condamnés. Ce fut le cas de 6 fusillés de février à avril.
Cette façon de s’asseoir sur les droits des prévenus ne s’appuyait sur aucune décision écrite de sa part. La circulaire ministérielle du 20 avril 1917, signée Painlevé, dont nous reparlerons plus avant, pour ses conséquences pour les condamnés à mort, l’obligea à donner toutefois, explicitement, des consignes claires. Que disait cette circulaire qui s’adressait au général en chef, exécutoire sur tous les théâtres d’opération ? :
« Lorsqu’un jugement prononçant la peine de mort sera devenu définitif, du fait que le condamné n’aura pas formé de recours en révision, ou que ce recours et le cas échéant le pourvoi en cassation auront été rejetés, le dossier de la procédure devra toujours m’être transmis, avec l’avis des autorités hiérarchiques et le vôtre sur l’opportunité de laisser ou non la Justice suivre son cours »
Ce texte clair, abrogeait la latitude du commandement et des juges à décider ou non d’un recours en grâce auprès du Président de la République. Le politique, par le biais du Ministre de la Guerre prenait en charge, à partir de cette date, la responsabilité d’ordonner exclusivement les exécutions parmi les condamnés à mort par la justice militaire.
A la lecture de ce texte le général Sarrail, commandant des armées alliées d’Orient, chargé de son application, l’avait répercuté dès le lendemain, mais en y ajoutant une nuance de taille, pour l’Armée Française d’Orient :
« Télégramme du 21 avril 1917 N° 2286/2M :
Donner ordres pour que dorénavant les condamnations à mort pour turcs, bulgares, grecs, etc. soient immédiatement suivies d’exécution. Seuls les soldats français doivent, avant d’être fusillés, avoir leur cas soumis au Conseil de Révision et appel au Président de la République »
Si en mai et juin ne sont respectivement fusillés qu’un turc et un grec, en respectant ce dispositif expéditif, le 23 août, un réseau d’Albanais, jugé par le Conseil de Guerre de la 57e DI, aboutissait à 12 condamnations à mort et à l’exécution de 10 d’entre eux le 25.
Avant de faire de même, sur requête de son commissaire rapporteur, le général de Vassart, commandant la 76e DI, avait demandé toutefois, le 25 août, la confirmation de cette règle de conduite concernant les prescriptions de la circulaire qui avaient été amendées entre le 11 juin et le 14 juillet pour faire face aux mutineries. Après cette date, les prescriptions de la circulaire ministérielle « Painlevé » du 20 avril 1917, s’appliquaient pleinement.
Le 29 août, le général Grossetti, commandant l’Armée Française d’Orient, répondait :
« Le recours en grâce ne s’applique qu’aux militaires français, aux militaires étrangers servant dans les régiments étrangers et aux indigènes incorporés sous le drapeau français. Quant aux condamnés grecs, turcs et bulgares, rien n’est changé aux dispositions prévues par la note du 20 avril 1917 du Cdt des Armées Alliées notifiée le 21 sous le N° 2286M/2M par l’Armée Française d’Orient.
En foi de quoi le général publiait la Note suivante :
Qu’avait-il été reproché à ce pope-cultivateur du village de Piskupige en Serbie ? En vue d’assurer la sécurité sur les arrières de l’Armée Française d’Orient, obligation avait été faite aux civils de remettre leurs armes à feu, sous la menace dissuasive de la note N° 5009/2 SR du 5 mai 1917 qui stipulait que tout détenteur d’armes non remises serait fusillé sur le champ. C’est ainsi que 5 habitants de Piskupige, trouvés possesseurs chacun d’un fusil Mauser, avaient été fusillés sur place. Auparavant le Commissaire de Police Benoist, Chef du Service de Sûreté de l’A.F.O, était venu s’enquérir des raisons du non-respect de la requête de venir déposer ses armes à la mairie. Ils répondaient qu’ils avaient obéi aux conseils du pope qui les avait encouragés à garder dissimulées leurs armes. Arrêté, accusé d’avoir fréquemment, en soirée, allumé du feu visible des lignes adverses, contrevenant au couvre-feu, d’avoir laissé partir son fils avec les troupes bulgares, lors du retrait de celles-ci, il était passé en jugement le 10 septembre et exécuté le lendemain au monastère de Kristofor près de Bukovo.
Tous ces acteurs autochtones s’appuyaient sur des réseaux. Condamné à mort le 10 avril, le turc Osman Balkalabatchich, avait cru alors échapper au poteau en livrant la bande avec qui il avait partie liée. Son espoir avait été déçu, car on a vu qu’il était exécuté le 21 avril. Ses révélations avaient permis la condamnation à mort des 12 du 23 août. Deux avaient échappé à l’exécution Adem Békir et Kerin Biniako. Ils avaient particulièrement intéressé le Commissaire Benoist car leurs révélations allaient pouvoir lui permettre de confondre sa bête noire : Themistokli.
Kerin Biniako, lieutenant de cette gendarmerie albanaise, Adem Békir, négociant, racontèrent au commissaire le premier qu’il avait assisté à une rencontre entre Sali Boutka et Themistokli, où ce dernier lui avait conseillé de rester avec les Bulgares, et le second qu’il avait servi de facteur pour transmettre les courriers de Themistokli aux responsables de l’espionnage germano-bulgares.
Avec ces preuves, l’arrestation était décidée, tandis que les deux qui avaient parlé, échappaient au poteau. Arrêté le 1er novembre, Themistokli était jugé le 7 novembre par le Conseil de Guerre de Salonique. Malgré une défense pied à pied, plaidant son patriotisme albanais, celui qui avait fait la pluie et le beau temps à Korytza de décembre 1916 à fin octobre 1917, décoré de la Croix de Guerre, était condamné à mort.
Le Commissaire-rapporteur arrêtait alors le dossier en concluant ainsi : « Jugement exécutoire après expiration des délais de révision et l’exercice du droit de grâce – Décret 9 juin 1916 et Circulaire ministérielle du 20 avril 1917 »
Le lendemain 8 novembre, Themistokli, dans les délais, se pourvoyait en révision.
Mais, à la surprise du Commissaire-Rapporteur, le processus était rapidement stoppé :
La pièce officielle relatant la décision prise par le Conseil de révision, fait apparaître la brusque interruption de la procédure.
L’exécution de Themistokli marquait un terme à la traque de ce groupe albano-musulman.
Le 26 novembre 1917, une autre longue enquête de notre Commissaire de Police Benoist livrait au Conseil de Guerre de la 76e DI un réseau d’espions, cette fois-ci au profit de la Bulgarie, tous condamnés à mort à l’issue du procès. Le général de Vassart n’a pas demandé cette fois confirmation de l’exécution immédiate, et l’a ordonnée pour le lendemain 27 novembre, à grand spectacle, près de la petite bourgade serbe de Holeven, la population tenue à distance, assistant à la fusillade, à 6h30, des 18 condamnés à mort, record des exécutions collectives par l’armée française dans la grande guerre.
Venue pour tendre la main aux serbes et combattre allemands, autrichiens et bulgares, l’armée française s’enfonçait dans la lutte sans merci contre des guérillas provoquées par la complexité des situations ethnico-politiques, les réprimant avec brutalité.
En métropole, on condamne en 1917 des civils : 10 en arrière et un en zone des armées. A l’arrière, 8 le sont pour espionnage ; tous étrangers : 3 espagnols, deux roumains, un mexicain, un néerlandais, un allemand ; ils ont tous été fusillés, le Président de la République ayant systématiquement refusé la grâce. Mata Hari et Bolo Pacha sont à ajouter à cette liste de 1917.
Un seul civil, Kalsch est condamné pour ce motif dans la zone des Armées pour des faits remontant à août 1914 en Lorraine. Les deux derniers le sont pour assassinat. Contrairement aux espions, ils ne sont pas exécutés, leur peine commuée en travaux forcés à perpétuité.
3-Les militaires condamnés puis exécutés dans les Conseils de Guerre permanents hors zone des Armées : 9
En métropole, il s’agit de 4 inculpés de trahison : Colnion, Bulme, Sideney, Capitaine Estève et de 4 assassins : Buttard, Margottin, Minangouin et Terrier. En Algérie, il s'agit de Mamou Ouali ben Yahia condamné pour meurtre.
Il faut rappeler que ces Conseils de Guerre disposent de 7 juges et que leurs Conseils de révision disposent de deux magistrats civils dont l’un d’eux est Président de droit. Le pourvoi en révision y existe depuis janvier 1915. Les 8 ont eu leur demande de grâce rejetée.
Hors Conseils de Guerre, deux autres militaires ont été jugés par des juridictions civiles et ont fini sur l’échafaud.
4-Les militaires condamnés par les Conseils de Guerre dans la zone des Armées
A-Evolution des différentes populations de condamnés à mort en 1917
Ne sont comptabilisés ici que les condamnés à mort sur le front Nord/Est, d’Orient, en Tunisie du Sud et au Maroc : territoires sur lesquels s’exerce, jusqu’en avril 1917, l’exceptionnalité de la demande de grâce.
Commençons par les bilans statistiques :
Pour information, aucune des données présentes dans ce tableau n’a été arrangée pour obtenir des calculs justes. Tous ces chiffres sont la traduction quantitative dans des tableaux mensuels de tous les noms des militaires condamnés à mort connus du Prisme.
Nota : dans le tableau ci-dessus, à partir du mois de mai, les conditions ayant changé, le pourcentage de grâces demandées n’a plus de raison d’être, les cases sont donc grisées. Le soldat Denison a été compté parmi les condamnés à mort/fusillés. Le soldat Moulia a été seulement compté parmi les condamnés à mort.
Que peut-on dire de global à la consultation de ce tableau ?
-Un record annuel du nombre de condamnations à mort :
1914 pour 4 mois : 209 ; 1915 : 461 ; 1916 : 380 ; 1917 : 671
-Un pic de condamnations à mort concentré de juin à octobre et d’exécutions sur juin.
-Une continuation du déclin du nombre d’exécutés :
1914 : 155 ; 1915 : 297 ; 1916 : 125 ; 1917 : 80
-Un taux de refus de grâce, non négligeable en début d’année, en voie ensuite de décroissance en fin d’année, portant le total d’exécutés avec autorisation du pouvoir politique à 64.
-Peu de cassations pour vices de forme en général, sauf en janvier, juin, juillet et août.
-Une intervention politique majeure : la circulaire ministérielle du 20 avril 1917 (présentée dans la sous-partie des condamnés en Orient).
Le tableau peut déconcerter par sa complexité. En fait, il permet d’avoir une vue globale. Par rapport à l’année 1916, qui a introduit le pourvoi en révision à l’initiative du condamné à mort par le décret du 8 juin, 1917 se caractérise par la mise en œuvre, à partir du 20 avril, de l’interdiction d’exécution de tout condamné à mort par un Conseil de Guerre sans autorisation du pouvoir politique.
On rappelle ici ce que dit cette nouvelle circulaire :
« Lorsqu’un jugement prononçant la peine de mort sera devenu définitif, du fait que le condamné n’aura pas formé de recours en révision, ou que ce recours et le cas échéant le pourvoi en cassation auront été rejetés, le dossier de la procédure devra toujours m’être transmis, avec l’avis des autorités hiérarchiques et le vôtre sur l’opportunité de laisser ou non la Justice suivre son cours »
Cette circulaire Painlevé abroge celle de son prédécesseur Millerand du 1er septembre 1914 rappelée ici :
« Dès qu'une condamnation capitale, prononcée par un Conseil de Guerre sera devenue définitive soit qu'elle n'ait pas été attaquée devant le Conseil de Révision, soit que le recours, ou le cas échéant le pourvoi en cassation ait été rejeté, soit enfin qu'il s'agisse de condamnation prononcée par un des Conseils de Guerre aux armées à l’égard desquels le décret du 10 août 1914 a suspendu le recours en révision, l'officier qui a ordonné la mise en jugement prendra immédiatement les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement à moins qu'exceptionnellement il n'estime qu'il y a lieu de proposer au Chef de l’Etat une commutation de peine »
C‘est un changement dans la lettre et dans l’esprit. Le soldat-citoyen ne peut plus être exécuté qu’avec l’aval présidentiel. L’autorité militaire, par sa justice, garde le pouvoir de condamner à mort, mais plus celui d’exécuter.
Jusque-là, les dossiers des condamnés à mort n’étaient adressés à la Direction du Contentieux et de la Justice militaire au Ministère de la Guerre que si le général de division ou un ou plusieurs juges sollicitaient une commutation de peine.
A partir du décret du 8 juin 1916, qui rétablissait le pourvoi en révision, le dossier, cette fois, avait commencé par transiter par le Conseil de révision, en cas de pourvoi par le condamné à mort.
L’accès à ce Conseil, ses modalités, lui étaient précisés par deux articles du Code de Justice Militaire :
-l’article 141 :
« Le Commissaire du gouvernement (rapporteur en temps de guerre) fait donner lecture du jugement à l’accusé par le greffier, en sa présence et devant la garde sous les armes.
Aussitôt après cette lecture, il avertit le condamné que la loi lui accorde vingt-quatre heures pour exercer son recours devant le conseil de révision.
Le greffier dresse du tout un procès-verbal signé par lui et le Commissaire du gouvernement »
-l’article 144 :
« Le délai de 24 heures accordé au condamné pour se pourvoir en révision court à partir de l’expiration du jour où le jugement lui a été lu.
La déclaration du recours est reçue par le greffier. La déclaration peut être faite par le défenseur de l’accusé »
Dans le cas où le jugement était annulé par ce Conseil, le dossier était transmis au Conseil de Guerre de la division qui allait avoir à juger à nouveau.
Sinon, si le Conseil n’avait pas trouvé de vices de forme, c’est le commissaire du Conseil qui faisait suivre le dossier sur Paris, si une demande de grâce avait été posée. Il le renvoyait au Conseil de Guerre qui avait jugé s’il n’y avait pas eu demande de grâce.
A partir de la circulaire du 20 avril, les circuits restaient les mêmes, à la différence que les commissaires-rapporteurs en Conseils de Guerre ou en Conseils de révision n‘avaient plus à se soucier de demandes de grâce ou pas, et pouvaient expédier, dès jugement fait, les dossiers revêtus des avis hiérarchiques sur Paris.
A l’armée la condamnation, au pouvoir politique la décision d’exécution.
Il est évident que la lettre du 20 avril est un texte de grande importance.
Il a fallu attendre 34 mois de guerre pour qu’en régime républicain, le pouvoir politique redevienne le recours suprême pour les condamnés à mort. Au-delà de cet énorme événement symbolique, Prisme, par l’étude statistique, a cherché à mesurer quel a été son impact.
Revenons à notre tableau
Les pourvois en révision :
Les condamnés, comme en 1916, y ont eu recours, à une confortable majorité (83%). Il est vrai que les accusés semblent placer peu d’espoir de voir leur procès cassé pour vice de forme, le pourcentage de refus ne pouvant que leur donner raison, bien que par deux fois, en juin, juillet, les Conseils de révision aient annulé en tout 85 jugements. C’est bien plus qu’en 1916.
Les demandes de grâce :
Elles sont très importantes dans le quadrimestre (janvier-avril) où elles étaient encore " sollicitables". Près de 8 dossiers de condamnations à mort sur 10 mentionnent une demande de commutation de peine des juges. Il s’agit ici de la continuation d’une tendance largement apparue dans le deuxième semestre 1916. Sans trop torturer les faits, on semble retrouver ici la situation d’avant la loi du 27 avril 1916. Cette loi supprimait les Conseils de Guerre Spéciaux, alors que ces derniers n’étaient pratiquement plus utilisés depuis des mois :
Soit 2 des 69 jugements du quadrimestre.
Ici, la circulaire du 20 avril rend obligatoire la transmission des dossiers alors que pour 78% d’entre eux, les juges le rendaient possible par leur demande de grâce. Comme en avril 1916, la circulaire d’avril 1917 consacre et rend obligatoire une mesure qui intervient, alors que, au fil des mois, s’était déjà mise en mouvement une pratique qui, dans l’esprit, reconnaissait l’aspiration des juges à laisser au politique la décision d’exécution :
La circulaire officialise donc, comme en 1916, un état de fait, qui n’a pas dû entraîner de levées de boucliers parmi les rapporteurs et juges des Conseils de Guerre, au vu de leur généralisation de l’appel aux politiques en dépit du fait que la note du 1er septembre 1914, qui l’interdisait quasiment, était toujours en vigueur. Entre 1914 et 1917, sans injonction gouvernementale ou parlementaire, c’est le non-recours à la demande de grâce qui a fini par devenir « exceptionnel », signe que les prescriptions terrorisantes du début de la guerre n’ont plus été respectées, tant elles ont paru intenables à ceux qui ont eu à les mettre en œuvre.
Prisme a noté un plus grand taux de refus de grâce dans ce premier quadrimestre sans y trouver d’explications. Il tentera d’en trouver dans les analyses mensuelles des dossiers de condamnés.
Lecture et exploitation du tableau pour le 1er quatrimestre :
Pour bien appréhender ce tableau, prenons janvier en exemple. Parmi les 55 condamnés à mort, 43 se pourvoient en révision, révision refusées pour 32 d’entre eux et accordées aux 11 autres, dont les dossiers sont transmis au Conseil de Guerre qui les rejugeront. Parmi les 44 restants, la grâce a été demandée pour 38, et donc non envisagée pour 6 (44-38). Le Président de la République a demandé pour 7 des 38 condamnés présentés à sa décision que « la Justice suive son cours ». Ainsi le total des exécutés qui est de 13, se répartit entre 6 dont le commandement a assuré l’exécution sans demande au Président et 7 exécutés avec l’aval du Président.
Voici ce que donne cette approche au niveau quadrimestre :
Restant de l’année :
A partir de mai, la demande facultative de grâce à la disposition du commandement n’existe plus. Dès lors, l’envoi des dossiers est automatique et donc les 58 exécutés de mai à décembre sont tous d’initiative politique. En réalité, cette responsabilité ne porte que sur l’exécution de 51 d’entre eux. En effet, comme nous le verrons plus en détail dans l’analyse du mois de juin, le général Pétain a été autorisé de mi-juin à mi-juillet, à décider à son niveau d’exécutions sans en demander la permission au pouvoir politique. Il a usé de cette latitude 7 fois.
Il s’agissait de l’épisode des mutineries, où la justice a dû s’adapter. On peut le subodorer quand on constate la variation anormale du taux d’annulation de jugements en juin-juillet que nous étudierons plus en détail dans la suite de ce travail.
Quoi qu’il en soit, avec la circulaire du 20 avril 1917, on s’éloigne définitivement de la carte blanche donnée au commandement en début de guerre. Cela rend d’autant plus importante la cellule qui, à la Direction du Contentieux et de la Justice Militaire à Paris, réceptionne les dossiers, les analyse, et décide, si l’exécution est refusée, de la durée de la peine d’emprisonnement selon ses critères propres. Certes, formellement, il n’y a pas décision mais simplement proposition, car cette dernière se doit d’être examinée, pour avis, par la Direction des Grâces et des Affaires Criminelles du Ministère de la Justice. La compulsation des archives de cette Direction montre qu’à 90% la Justice entérine les propositions de la cellule de Justice militaire. Quand rarement elle objecte, elle est soumise à forte pression du Ministère de la Guerre, pour revenir sur l’objection.
A la lecture des dossiers, on constate que le Président de la République a peu son mot à dire à ce sujet. Dès que la Direction des Grâces et des Affaires Criminelles a donné son avis, la Direction du Contentieux et de la Justice Militaire récupère le tout et fait le nécessaire auprès de la Chancellerie de l’Elysée, pour préparer le document à signer par le Président.
Désormais, plus encore qu’en 1916, puisque dorénavant, tous les dossiers de condamnés à mort passent entre ses mains, cette cellule devient, jusqu’à la fin de la guerre, le vrai tribunal qui juge en dernier ressort et considère le dossier du Conseil de Guerre comme un recueil de pièces d’instruction qui va lui permettre de prendre sa décision. Il y a un déclassement. Le jugement du Conseil de Guerre n’est plus considéré que comme avis et non une décision souveraine d’un tribunal. L’autorité de la « chose jugée », la condamnation à mort, n’est pas contestée, mais la nature de l’application de la peine est remise en question au sein d’un cénacle restreint siégeant rue de Bellechasse à Paris. Prisme a déjà, dans son étude sur 1916, marqué son étonnement devant l’existence de cette cellule quasi clandestine, aux membres et à leurs qualités inconnus, dont les archives ont disparu et qui dans l’ombre a finalement fixé le sort des condamnés à mort, partiellement jusqu’au 20 avril 1917 puis en totalité après cette date.
Ceci dit, l’événement statistique majeur de 1917 est la chute spectaculaire du nombre de fusillés : 80 à opposer aux 297 de la cohorte de 1915, alors que le bon sens commun imagine que, face au massif mouvement de désobéissance des mutineries, une répression sanglante aussi massive a dû lui correspondre.
On peut envisager l’hypothèse selon laquelle, si la circulaire Painlevé avait été publiée après la victoire de la Marne, chose possible car la République n’était plus en danger, on travaillerait aujourd’hui sur un corpus de fusillés bien moins conséquent qu’il ne l’a été.
1- Cohorte de Janvier : 55 condamnés à mort, 13 exécutés, 31 commutations de peine, 11 jugements annulés pour vice de forme par les conseils de révision d’armée, sur les 43 examinés.
On dénombre 55 condamnés à mort, dont 11 ont eu leur jugement annulé par le Conseil de révision, sur un total de 43 qui s’étaient pourvus en révision. Pour les 44 restants, le sort de 38 d’entre eux a été soumis à la décision du Président de la République soit 69%. Celui-ci a accordé une commutation à 31 d’entre-deux. Au final, 13 soldats de la cohorte ont été exécutés.
Dans notre article sur la justice au quotidien au sein d’un corps de troupe, nous avons déjà étudié le cas d’un soldat gracié au cours de ce mois. Nous renvoyons les lecteurs vers cette étude de cas.
Un multi-récidiviste gracié:
Onze novembre 1916 vers 13h30, le brigadier Couroussi du 11e escadron du train des équipages affecté à l’ambulance 8/11 à Lignères déclarait aux gendarmes Lamy, Baudu et Quéméneur de la prévoté de la 21e division d’infanterie : je viens vous amener deux déserteurs que je viens d’arrêter. Ces 2 déserteurs avaient été dénoncés par des civils. Incarcérés à la prison militaire de la division, interrogés, le premier soldat se nommait Rostagni du 173e RI. Il a reconnu être déserteur.
Trois jours auparavant, le 8 novembre, vers 18h00, le sergent Van Hanve procédait à l’appel des hommes versés à la section spéciale de discipline de la 126e DI, il venait d’apprendre par le caporal Collet, l’absence du soldat Rostagni. Les recherches pour le retrouver, restèrent vaines. La section partit, sans Rostagni, exécuter des travaux en avant de l’ouvrage n°10 à Avocourt. Trois jours plus tard, Rostagni était arrêté aux environs de Lignères par le brigadier Couroussi. Il était transféré à la prison du QG à Vavincourt mais il s’échappa à nouveau en pratiquant une brèche dans le mur du local où il était détenu. Puis il se rendit à Bar-le-Duc, prit un train de permissionnaires et arriva à Paris. Rostagni, accompagné d’un comparse, le soldat Ausilia, y avait croisé le soldat Lestamps, du 4e RA, qui lui avait confié sa musette le temps de faire une course. Au retour de Lestamps, Rostagni et Ausilia avaient disparu. Le soldat Lestamps déposa une plainte auprès du commissaire militaire de la gare. Rostagni était arrêté au moment où il allait prendre le train pour les Alpes-Maritimes en possession des objets confiés par Lestamps. Son arrestation permit de mettre à jour sa désertion. Rostagni fut transféré à la caserne de Reuilly.
Après avoir comparu 2 fois devant un Conseil de Guerre, Rostagni avait été transféré à la section spéciale de discipline de la 126e DI, le 31 août. Il avait déjà été condamné le 23 mars à 3 ans de travaux publics pour désertion à l’intérieur en temps de guerre, puis le 28 août à 10 ans de travaux publics pour abandon de poste en présence de l’ennemi. Par 2 fois, les peines avaient été suspendues. Considéré comme assez bon travailleur quand le travail lui plaisait, Rostagni a été l’objet de nombreuses punitions : non malade, mauvaise volonté au travail, paroles déplacées ou ordurières, n’hésite pas à abandonner le travail quand il ne lui plait pas. Rostagni avait été blessé à la bataille de la Marne et plus légèrement au bois de la Gruerie.
Devant ces faits, le commissaire-rapporteur Gazier avait estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre Rostagni en ce qui concernait le vol des affaires du soldat Lestamps mais en revanche, il demanda le renvoi de Rostagni devant le Conseil de Guerre pour avoir abandonné, sans autorisation, son poste en présence de l’ennemi le 8 novembre aux environs du réduit d’Avocourt. Le témoin convoqué était le caporal Collet.
Extraits de l’interrogatoire de Rostagni :
La remarque de Rostagni ne manque pas de pertinence, mais la possibilité par ce constat d’échapper à la peine de mort avait été réduite à néant dès septembre 1914, quand le Ministre de la Guerre, Millerand, avait décrété que le mot « poste » dans la notion d’abandon de poste est l’endroit où le militaire doit être présent pour l’accomplissement de son devoir et de son service.
Dès lors, aucune réticence de la part du commissaire rapporteur à requérir pour abandon de poste en présence de l’ennemi.
Durant son interrogatoire, le caporal Collet déclara :
Le 12 janvier 1917, le Conseil de Guerre de la 126e DI s’était réuni à Longchamp-sur- Aire. Hasard, il était présidé par le colonel D’Albis de Gissac commandant le 173e RI.
Deux questions ont été posées aux juges :
-le soldat Rostagni du 173e RI est-il coupable d’avoir, le 8 novembre 1916 à l’ouvrage n°10 aux environs du réduit d’Avocourt, abandonné son poste sans autorisation ?
-le dit abandon de poste a-t-il eu lieu en présence de l’ennemi ?
A ces 2 questions, les juges ont répondu « oui » par 3 contre 2 et ont condamné Rostagni à la peine de mort en application des articles 213, 187 et 139 du code de justice militaire. Les circonstances atténuantes ont été refusées par 3 voix contre deux.
Rostagni s’était pourvu en révision. Le Conseil de révision de la 2e Armée qui s’était réuni le 24 janvier, avait rejeté le recours formé.
Le 22 février, le président de la République a commué la peine de mort en 20 ans d’emprisonnement. Le 3 mars, le sergent Harel commis-greffier a donné lecture de la décision présidentielle au soldat Rostagni.
Par décret du 22 décembre 1921, il a été accordé au détenu une remise de peine de 10 ans. Le 28 avril 1922, Rostagni a bénéficié d’une remise du restant de sa peine.
Il ne faut pas croire que le dossier du soldat Rostagni est un cas isolé. Plusieurs fois condamné, la peine à chaque fois suspendue est un « grand classique » que l’on trouve assez fréquemment dans les archives de la justice militaire.
Un abandon de poste lourdement sanctionné:
Le 6 novembre 1916 vers 17h30, le sergent de ville Pinguet du commissariat de police de Gentilly intervient avec son collègue sur un groupe d’individus dans le but de connaître la situation d’un militaire signalé comme déserteur. Le soldat s’est alors enfui, il a été rattrapé. Pendant son arrestation, le sergent de ville Pinguet a eu sa veste déchirée et son collègue a reçu des coups. Invité à suivre les 2 sergents de ville, le soldat a refusé de les suivre au commissariat et s’est roulé par terre. Les autres membres du groupe se sont alors opposés à son arrestation sans voies de faits. Avec l’aide de 4 autres policiers du commissariat, le soldat et 3 autres personnes ont été conduits au commissariat.
Le soldat est « fortement épris de boisson ». Le soldat décline finalement son identité, il s’appelle Lecoq Maurice Marcel, il est célibataire. Durant son interrogatoire, Lecoq a déclaré avoir été puni de 8 jours d’emprisonnement en 1912 pour coups et blessures. Il a déclaré appartenir à la 19e compagnie du 226e RI, avoir quitté son unité à Froissy dans la nuit du 1er au 2 novembre, puis pris un train à Amiens pour Paris. Enfin, il a déclaré avoir trop bu la veille et s’être simplement débattu pour ne pas se laisser emmener. Lecop précise « qu’il regrette sincèrement son acte ». Extrait de la prison du Cherche-Midi, Lecoq a été conduit le 9 novembre en gare de Creil pour être transféré vers son unité où il arriva entre 2 gendarmes le 12 novembre.
Le 226e RI fait partie de la 70e DI. Le 22 septembre, le 226e RI débarque au camp n°63 à Lamotte en Santerre ; il y restera jusqu’au 6 octobre, date à laquelle le régiment va occuper le camp n°4 à Froissy. Le 7, il se déplace jusqu’au camp n°56 entre Cappy et Eclusier. Le 12, le 226e quitte ses emplacements pour monter en ligne à côté de Biaches. Le 20, le régiment est relevé et retourne au camp n°4 à Froissy. Premier novembre, une partie du régiment, déjà alerté, était montée en ligne depuis la veille, à la disposition de la 77e DI ; la 19e compagnie quitte le camp n°4 vers 17h00. A 19h20, elle est au point 512. A 22h00, son installation est terminée dans la tranchée Sophie. Les 24 et 28 septembre, le 226e a reçu 7 officiers, 392 soldats et s/officiers. Pendant cette période, le régiment a enregistré environ 34 tués et 105 blessés.
Le 1er novembre, la 19e compagnie se trouvait au camp 4 de Froissy ; elle attendait l’ordre de partir aux tranchées vers 17h00. Vers 15h00, le caporal Melle chercha vainement Lecoq et malgré les recherches, il manquait à l’appel.
Au moment de sa désertion, Lecoq était en prévention de Conseil de Guerre pour 3 désertions successives (les 2, 15 et 22 octobre 1916) s’évadant à chaque fois avant l’arrivée de l’ordre d’écrou. Ce soldat avait été transféré le 10 août en provenance du 279e RI après une condamnation du Conseil de Guerre de la 70e DI à 6 mois de prison pour désertion à l’intérieur en temps de guerre, peine suspendue. Ses supérieurs ont une mauvaise opinion de lui, « ses désertions donnant le plus mauvais exemple aux autres soldats de la compagnie qui le voient se dérober aux pénibles devoirs auxquels ils sont astreints ».
Une plainte a été déposée contre Lecoq. Il a été inculpé d’abandon de poste en présence de l’ennemi et de désertion à l’intérieur en temps de guerre. Lecoq a comparu le 11 janvier 1917 à 8h30 devant le Conseil de Guerre de la 70e DI.
Dans les notes d’audience, Lecoq reconnaît les 3 premières désertions. Il se justifie ainsi : « j’étais sans nouvelle de ma famille qui m’avait délaissé ». Pour le dernier abandon de poste, Lecoq précise « qu’il ignorait que la compagnie devait recevoir l’ordre d’attaquer, je m’ennuyais, je ne recevais ni nouvelles, ni lettres ; j’ai fait l’Artois, Verdun, mais pas la Somme ».
Le premier témoin, le sergent Henry, indique que : « le commandant de la compagnie avait rassemblé les chefs de section pour nous donner les ordres avant d'aller en ligne, attaquer, les hommes le savaient ». Suite à cette déposition, interrogé par le Président du Conseil de Guerre, Lecoq indique : non, je n’ai rien à dire. Le second témoin, le caporal Melle confirma avoir constaté la disparition de Lecoq vers 15h00. Il indique avoir effectué des recherches avec le sergent Henry mais sans résultat et ne l’avoir revu que le jour de la relève près du château de Cappy quand les gendarmes l’ont ramené.
Durant son interrogatoire, Lecoq reconnaît avoir quitté la compagnie vers 15h00. Il indique qu’il savait parfaitement que le bataillon était alerté et devait monter le soir même au point 512. Quand on l’interroge sur le fait qu’il est coutumier de la désertion, Lecoq répond qu’il s’ennuie, qu’il ne se plait pas au régiment, qu’il veut aller au 360e RI. Quand on lui demande pourquoi, après avoir été un bon sujet, nommé caporal, vous avez changé subitement, pourquoi ? Lecoq répond : par dépit d’avoir été versé au 279e RI après la dissolution du 237e RI. Lecoq précise qu’il regrette ses actes mais que c’est par ennui qu’il a pris l’habitude de déserter.
Sept questions ont été posées aux juges. Les 5 dernières questions concernaient les inculpations de désertion à l’intérieur en temps de guerre. Conformément au code de justice militaire, ces désertions ne sont jamais sanctionnées par la peine de mort mais par 2 à 5 ans de travaux publics.
La première question était : le soldat Lecoq Maurice Marcel du 226e RI est-il coupable d’avoir, le 13 septembre 1916, abandonné son poste, quittant sa compagnie qui se trouvait dans les tranchées près de Frise et au moment où elle venait de recevoir l’ordre de se porter en ligne à l’est de Cléry ? La 2ème question était : ledit abandon de poste a-t-il eu lieu en présence l’ennemi ?
A la 1ère question, les juges ont déclaré : à l’unanimité des voix, l’accusé est coupable
A la 2e question, les juges ont déclaré : à l’unanimité des voix, oui
Au nom du peuple français, le Conseil de Guerre de la 70e DI a condamné le soldat Lecoq à l’unanimité des voix à la peine de mort en application des articles 213, 231, 232, 234 et 135 du code Justice militaire.
Lecoq s’était pourvu en révision le 12 janvier, le Conseil de révision de la 1ère Armée a examiné le dossier :
Le 18 janvier, le Conseil de révision de la 1ère Armée a rejeté le pourvoi formulé par Lecoq.
Le 15 février 1917, un recours en grâce a été adressé au président de la République. Le 19 février, après examen du dossier, celui-ci n’a pas cru devoir accueillir le recours en grâce du soldat Lecoq.
Dans le dossier des affaires criminelles et des grâces du Ministère de la Justice, on peut lire cette appréciation en fin de texte : aucune objection aux conclusions tendant à laisser la justice suivre son cours.
Le 22 février 1917 à 6h30 du matin, à mi-chemin entre Berneuil et Attichy près du dépôt de munitions, le commis-greffier Desneiges a donné lecture du jugement, du rejet du recours en révision et du rejet du recours en grâce devant les troupes réunies. Le médecin aide-major a constaté le décès du soldat Lecoq.
On notera qu’au cours de ce mois de janvier 1917 où l’envoi d’un recours en grâce auprès du Président de la République devrait toujours rester exceptionnel, 79% de demandes de grâces seront adressées à la Présidence de la République dont celle concernant le soldat Lecoq. Par contre, les juges n’ont pas jugé bon d’accorder le bénéfice des circonstances atténuantes au soldat Lecoq contrairement au cas précédent. Pourquoi : absence d’une blessure ou d’un acte de bravoure pour le justifier par exemple ?
Les exécutés à l’initiative du commandement :
Ils sont 4 en janvier, le plus fort nombre du 1er quadrimestre. Aucun n’est de nationalité française : 2 légionnaires allemands, 2 tirailleurs tunisiens, l’un arabe, l’autre israélite.
Les deux légionnaires :
Servant au 1er Régiment de Marche/1er RE au Maroc, ils ont déserté et rallié une tribu « dissidente » avec le projet d’être amenés dans le Rif où se trouverait un groupe de légionnaires déserteurs, combattant avec les rebelles.
Hebel s’est enfui avec ses munitions le 16 octobre 1916 avec 2 camarades, Axt et Mader, qui n’ont pas été repris. Gosch est parti seul avec fusil et cartouches le 22 octobre et a rejoint la tribu des Riatas, où il a retrouvé les trois autres. Au cours de leur transit vers le Rif, Gosch et Hebel ont été capturés. Condamnés à mort le 9 janvier 1917 par Conseil de Guerre à Oujda, leur pourvoi en révision rejeté le 13, ils ont été exécutés le 16 sur autorisation du Résident Général Lyautey le 15. Une longue incarcération, donc, a été suivie d’une procédure rapide en janvier. Lyautey, en arrêtant à son niveau la décision n’a pas fait un abus de pouvoir comme Sarrail. Depuis le début de la guerre, il a obtenu, sur sa demande, d’être décideur ultime en zone de guerre marocaine.
Les deux tirailleurs :
A la 38e DI, division formée de recrues d’Afrique du Nord, il s’est agi aussi d’une double exécution le 14 février 1917 à 9h30, à Pavant dans l’Aisne, pour deux hommes du 8e Régiment de Marche de tirailleurs, recruté en Tunisie. Simon Krief, qui y sert, est un peu une anomalie. Pour éviter les heurts, on affecte normalement les musulmans dans les régiments de tirailleurs et les israélites dans ceux de zouaves. Cela a ainsi été le cas pour Krief, engagé volontaire en 1914, qui, incorporé dans un régiment d’artillerie, a rejoint ensuite le 4e zouaves avec lequel il a débarqué aux Dardanelles avant d’y être blessé à la main, par balle, le 2 août 1915. Rapatrié à Tunis, longtemps au dépôt de son régiment, il a été envoyé au front au 8e Tirailleurs le 20 septembre 1916, suite à une condamnation à un mois de prison pour désertion en Tunisie, peine suspendue. Ayant obtenu une permission de trois jours de détente à Paris, le 20 septembre, il n’est pas rentré à l’issue de celle-ci et a été arrêté à Paris le 16 octobre et mis aussitôt en prévention de Conseil de Guerre.
Il explique sa disparition par sa déception de ne pas avoir été naturalisé français :
Le S/Lt Collomb, auteur du rapport, s’est révélé peu sensible à l’aspiration de Krief :
Alors que l’instruction de son procès suit son cours, le régiment, reprenant des forces et des effectifs entre le 1er novembre et le 10 décembre, est rappelé à Verdun pour donner un nouveau et sanglant coup de boutoir. Krief est renvoyé à sa compagnie en lui soulignant qu’une conduite exemplaire pourrait bien arranger son affaire. Le 15 décembre, il fait partie des vagues d’assaut mais disparaît au cours de la progression et on le retrouve à Verdun. Il explique qu’avec un tirailleur, ils ont convoyé des prisonniers à l’arrière. Il exhibe le reçu d’un officier attestant de cette activité. Le commandement réplique que les consignes pour l’assaut étaient formelles : tous en avant, ne pas s’occuper des prisonniers. Dès lors, l’abandon de poste est caractérisé.
C’est aussi pour un abandon de poste, au cours de cette même attaque du 15 décembre, que le sergent Chaib el Feguig Kilani ben Mohamed se retrouve au Conseil de Guerre le 29 janvier en compagnie de Simon Krief. Chef d’une demi-section, il a disparu alors que la compagnie allait sortir des tranchées. Il ne la rejoindra que le 20 à Verdun lors de sa descente au repos. Il explique son absence par le combat mené au sein d’une unité voisine, puis le 19 par sa présentation à un poste de secours pour pied gelé, d’où un médecin le renverra sur Verdun à pied, refusant de l’évacuer. Interrogé, ce dernier dira qu’il s’agissait d’un simple œdème bénin, si peu préoccupant que le sergent Kilani ne s’est présenté à la visite que le 23. Kilani, au front depuis 13 mois, est mal noté, puni plusieurs fois pour négligences dans son service.
Krief et Kilani se sont pourvus en révision, laquelle a été rejetée le 7 février.
Les juges de la 38e division, ci-dessus, n’ont pas cru proposer une demande de commutation.
En résumé, la non-transmission à Paris des dossiers des légionnaires allemands correspond à une situation particulière sans rapport avec le front français. Pour les deux tirailleurs, à une époque où leur régiment a été de tous les coups durs au 2ème semestre 1916 à Verdun, leur tentative de se créer un alibi pour couper à l’affrontement a incité à ne pas laisser au pouvoir politique la décision finale.
Ceci étant, on voit bien, par le côté marginal de ces exceptions, dès ce mois de janvier, combien le recours au Président de la République est entré dans les pratiques et combien son absence devient exceptionnelle.
2- Cohorte de Février : 16 condamnés à mort, 3 exécutés, 12 commutations de peine, 1 jugement annulé pour vice de forme par les conseils de révision d’armée, sur les 10 examinés.
Le nombre de condamnés à mort est en nette diminution, on en compte 16 dont le sort de 12 d’entre eux a été soumis à la décision du Président de la République. Celui-ci a accordé une commutation de peine à 11 d’entre-deux. Dix pourvois en révision ont été demandés, soit 63%, et neuf ont été refusés. Au final, 3 soldats de la cohorte ont été exécutés.
Pas de recours en grâce ?:
Le 22 février, le Conseil de Guerre de la 37e DI s’était réuni pour juger le soldat Mayet du 2e régiment de marche de zouaves. Le Conseil de Guerre était très majoritairement composé d’officiers et de sous-officiers de régiment de tirailleurs ou de zouaves.
Mais revenons un peu en arrière. A peine relevé, le 2e zouaves était à nouveau mobilisé le 15 juillet pour repousser à son tour l’avance allemande en direction de la poudrière de Fleury. Les pertes furent lourdes jusqu’à 28 juillet, jour de la relève. Après quelques jours passés en Lorraine, le 1er novembre, le régiment était de retour dans le secteur du fort de Douaumont occupant un secteur sous les bombes allemandes. Le 15 décembre, comme toute la 38e DI, dont Krief et Kilani, il reprenait l’offensive, attaques et contre-attaques se succèdent. Le 18, le 2e zouaves était relevé, il avait perdu plus la moitié de son effectif.
Le soldat Mayet appartient à la 3e compagnie. Dans le rapport du commissaire-rapporteur, on apprend que la présence de ce militaire a été constatée en dernier lieu le 14 décembre en soirée. Mayet prétend être sorti de la tranchée de départ avec ses camarades le 15 au matin ; après 400 mètres, il affirma s’être enlisé dans un trou d’obus. Mayet souligna que son pied gauche lui faisait mal. Il indiqua avoir entaillé son brodequin. Rejoint par des tirailleurs, il indiqua avoir combattu avec ces derniers pendant plusieurs heures. Les tirailleurs ayant battu en retraite, Mayet affirma être resté sur place quand il fut rejoint par sa compagnie. Il aurait été là quand l’adjudant Marceau a été fait prisonnier. Le 17, Mayet serait revenu aux Trois Cheminées, où un médecin lui aurait donné verbalement l’autorisation de se reposer. Le 18 décembre, Mayet a rejoint son unité.
Mayet ne semble pas très bien « noté », il a plusieurs condamnations à son passif.
Dans son rapport, le commissaire-rapporteur souligna que Mayet n’a pas pu donner d’informations sur le régiment de tirailleurs avec lequel il a combattu, ni d’attestation de présence. Il n’a pas questionné l’encadrement du régiment de tirailleurs pour savoir où était son unité. Mayet affirma qu’il n’a pas pu se faire comprendre des tirailleurs. Le rapport du commissaire-rapporteur doute fortement du fait que le médecin du poste de secours se soit refusé à lui donner une fiche constatant qu’il l’avait autorisé à se reposer ; en aucun cas Mayet n’avait le droit de se rendre à Verdun de son propre chef. Mayet s’était également plaint d’avoir mal au pied gauche. Examiné sur la demande du commissaire-rapporteur par le médecin aide-major Vincens, celui-ci l’a déclaré parfaitement apte au service mais a demandé que Mayet soit doté de brodequins à sa taille.
Interrogés, les témoins indiquèrent qu’il n’était pas possible de rester enlisé dans le secteur où s’est passé l’assaut et que son bataillon n’ayant pas battu en retraite, Mayet n’a pu être rejoint par celui-ci. Ils confirmèrent que les circonstances de la capture de l’adjudant Marceau sont inexactes : cet événement a eu lieu le 16 au matin et non pas le 15 ; trois militaires purent seuls, s’échapper : le sergent Dubost, le sergent Lacroix et le zouave Ribereau qui ne connaissaient pas l’inculpé. Si Mayet avait été présent, il aurait été soit capturé comme l’adjudant Marceau, soit il se serait enfui avec les autres militaires.
Pour le commissaire-rapporteur, l’abandon de poste en présence de l’ennemi était « parfaitement » caractérisé. Au vu du rapport et des conclusions du commissaire-rapporteur, conformément à l’article 108 et 111 du code de justice militaire, il a été ordonné la mise en jugement de Mayet et son renvoi devant la Conseil de Guerre de la 37e DI.
Les témoins donnèrent leurs versions des faits :
-le sergent Lacroix réfuta les dires de Mayet :
-le sergent Dubost réfuta également les dires de Mayet, en particulier, Dubost précisait que la compagnie n’avait pu rejoindre Mayet puisque qu’elle n’avait pas battu en retraite :
Durant son interrogatoire, Mayet indiqua :
Dans les notes d’audience :
On note des divergences dans les déclarations de Mayet entre son interrogatoire et les notes d’audience.
A l’issue des débats, deux questions ont été posées aux juges. A l’unanimité, les juges ont condamné Mayet à la peine de mort en application des articles 213, 139 et 187.
Mayet s’est pourvu en révision mais le Conseil de révision de la 5ème Armée a rejeté son pourvoi le 26 février.
Parmi les archives du ministère de la justice, on ne trouve pas trace d’un éventuel recours en grâce adressé à la Présidence de la République. Dans le dossier, un courrier daté du 28 février émanant du général commandant la 37e DI, fixe la date de l’exécution au 2 mars à 8h00. Ce courrier nous laisse penser qu’aucun recours en grâce n’a été adressé à la Présidence de la République.
Selon les termes de la procédure, en réparation du crime d’abandon de poste en présence de l’ennemi, le 2 mars 1917 à 8h00 à Bezannes, après lecture du jugement, après la constatation du décès du soldat Mayet par le médecin-major commis à cet effet, le greffier a dressé le procès-verbal d’exécution à mort. Mayet est le seul des condamnés à mort de février sur 12 dont on n’a pas transmis le dossier avant exécution.
L'exemplarité recherchée pas vraiment obtenue:
Dans son rapport, le capitaine Maury commandant la 7e compagnie du 4e RI a demandé la traduction devant le Conseil de Guerre du soldat Varain : dans la nuit du 22 au 23 novembre 1916, la compagnie quittait son cantonnement pour aller occuper en première ligne le secteur du Ravin de la Fausse cote. En arrivant aux casernes Marceau, Varain quitta la colonne, se cacha dans les bâtiments les 23 et 24 novembre. Le 25, il se présenta au sergent Sey resté aux casernes Radet et demanda à être examiné par un médecin qui le reconnut « non malade ». Le sergent Sey lui ordonna immédiatement de rejoindre la compagnie en ligne. Varain se mit en route mais en traversant les casernes Marceau, il s’arrêta de nouveau et y resta les 26 et 26. Le 28, il fut découvert par le sous-chef de musique Escoffier qui s’empressa de prévenir le sergent Sey. Le 29, Varain se présenta aux casernes Radet à l'officier-payeur Labbé qui ordonna au sergent Monin de conduire Varain à sa compagnie où il arriva le 29 vers 16h00.
Pour information, les casernes Radet et Marceau sont éloignées d’environ 4 kilomètres.
Au sein de la 9e DI, le 4e RI était longtemps resté stationné dans le secteur de la cote 285 en Argonne où régnait la guerre des mines. Début septembre, après de nombreuses pertes, il quittait ce secteur pour prendre un peu de repos à Beurey, à l’Ouest de Bar-le-Duc. Début octobre, le 4e RI a été mis en ligne à Verdun qu’il quittera pour une très courte durée avant d’être rappelé le 2 novembre, pour tenir le secteur des ravins de la Fausse cote, de l’étang de Vaux et du Bazil. Après avoir perdu 700 hommes, le 4e RI quittera Verdun le 11 décembre 1916.
Le capitaine Maury, qui décrit Varain comme un mauvais soldat déjà incarcéré pour des faits similaires, a demandé sa traduction devant le Conseil de Guerre pour « abandon de poste sur un territoire en état de siège ».
A ce stade, on doit faire remarquer 2 choses :
-l’abandon de poste sur un territoire en état de guerre, demandé par le capitaine, est sanctionné par une peine de 2 à 5 ans de prison en application de l’article 213 paragraphe 2 du Code de justice militaire
-il faut rappeler le texte, déjà signalé pour Rostagni en janvier, signé de Millerand sur l’abandon de poste en présence de l’ennemi : le militaire coupable n’a fait autre chose que se soustraire à l’exécution de l’ordre qui l’oblige à être présent à une place déterminée. Le mot « poste » doit être pris dans les sens le plus étendu, il signifie « l’endroit où le militaire doit être présent pour l’accomplissement de son devoir et de son service »
Le bulletin n° 1 de Varain présente 8 condamnations pour des motifs divers, sanctionnés par des peines de prison, dont 2 par les Conseils de Guerre pendant son temps de service. En juin 1915, Varain a été condamné pour ivresse et outrages à agents de la force publique. Varain a été transféré au 4e RI le 25 juillet 1915.
Après l’interrogatoire des témoins et de l’inculpé, le commissaire-rapporteur a rédigé son rapport en demandant que Varain soit traduit devant le Conseil de Guerre pour : abandon de poste et refus d’obéissance en présence de l’ennemi. Cette demande est beaucoup plus grave que celle du capitaine Maury, elle est sanctionnée par la peine de mort.
Interrogé, Varain fit les déclarations suivantes :
Le sergent-major Sey fournissait sa version des faits :
Le sous-chef de musique fournissait également la sienne :
A l’issue des débats, le Président posa les questions suivantes :
1-le soldat Varain du 4e RI est-il coupable d’avoir dans la nuit du 22 au 23 novembre 1916, aux casernes Marceau, sur le front de Verdun, abandonné son poste dans sa compagnie qui se rendait en ligne ?
2-cet abandon de poste a-t-il eu lieu en présence de l’ennemi ?
Question subsidiaire (si le conseil répondait affirmativement à la 1re question et négativement à la 2ème question, il y aurait lieu de poser cette question) : cet abandon a-t-il eu sur un territoire en état de guerre ?
3-le même Varain est-il coupable d’avoir le 25 novembre aux casernes Radet, refusé d’obéir à l’ordre relatif au service qui lui a été donné par le sergent Sey, du même régiment, qui lui ordonnait de rejoindre sa compagnie qui était en ligne ?
4-ce refus d’obéissance a-t-il eu lieu en présence de l’ennemi ?
Question subsidiaire (s’il y a lieu) ce refus d’obéissance a-t-il eu lieu sur un territoire en état de guerre ?
A la 1ère question, les juges ont répondu oui à l’unanimité
A la 2ème question, les juges ont répondu oui à trois voix contre 2
A la 3ème question, les juges ont répondu oui à trois voix contre 2
A la 4ème question, les juges ont répondu non à trois voix contre 2
A ce stade, les réponses des juges aux 2 premières questions condamnaient Varain à la peine de mort. La question des circonstances atténuantes a été posée : à trois voix contre 2, les juges ont répondu non. On voit que les avis étaient assez partagés.
Le dossier du Ministère de la Justice concernant Varain mentionne qu’aucun pourvoi en révision n’a été présenté.
Néanmoins, un recours en grâce a été adressé à la Présidence de la République.
Dans son argumentaire, la direction des grâces et des affaires criminelles suivait la « Guerre » sur le fait que d’une part « l’exemplarité recherchée n’est vraiment obtenue que si le châtiment suit de près la défaillance » ce qui n’était pas le cas ici et d’autre part que la peine n’a été prononcée qu’à une voix de majorité. Il faut remarquer que la « Guerre » avait demandé une commutation en 20 ans de prison.
La peine de mort ayant été commuée en 20 ans de prison, Varain a été remis à la Prévoté de Troyes le 20 avril 1917 qui l’a conduit à la prison militaire d’Orléans. Incarcéré à la maison centrale de Fontevrault, Varain a été élargi le 23 décembre 1921 suite à l’exécution de la décision ministérielle n° 7447 2/10. A peine libéré, Varain était à nouveau condamné à de la prison par un tribunal correctionnel.
3- Cohorte de Mars : 22 condamnés à mort, 5 exécutés, 15 commutations de peine, 2 jugements annulés pour vice de forme par les conseils de révision d’armée, sur les 17 examinés.
Sur 22 condamnés à mort, deux ont eu leur jugement annulé sur les 17 qui s’étaient pourvus en révision. Sur les 20 restants, les juges ont proposé 19 demandes de grâce. 4 ont été refusées entraînant 4 exécutions auxquelles s’est ajoutée celle de l’unique cas dont les juges ont estimé devoir laisser le politique en dehors de la décision.
On trouve 3 tentatives d’homicide et 2 désertions répétées. Celui exclu d’une grâce potentielle, Ferdinand Lemoine, fait partie des trois premiers. Agé de 40 ans, servant dans un régiment territorial, il avait tiré à bout portant sur l’adjudant Sirop, sans l’atteindre. Il avait déjà écopé de 7 ans de travaux publics en mai 1915 pour outrages à supérieurs, peine suspendue. Jugé le 5 mars, son pourvoi rejeté le 8, il était exécuté le 10. On peut supposer que c’est le tir sur ce sous-officier qui a déterminé les juges à faire cette exception à la tendance générale de demande de grâce en ce mois de mars.
Cela n’a pas joué pour les deux autres dans ce cas : la grâce a été demandée et refusée. Ils appartenaient tous les deux au 4e Bataillon d’Infanterie Légère d’Afrique, « portion centrale » en Tunisie et détachements au Maroc. Les plus amendables des recrues de ces Bataillons combattaient depuis l’hiver 1914 en France dans 2 Bataillons de Marche : le 1er et le 3e. Les plus indisciplinés étaient gardés en Afrique du Nord. Au cours d’une altercation, en octobre 1916, trois d’entre eux s’étaient rebellés contre un caporal et l’un deux, Jean Marie Cadot, avait fini par tirer sur ce gradé. A Médenine, en Tunisie, Prosper Godot, avait été de même jugé pour un tir sur le Sous-Lieutenant Poli en décembre 1916. Devant des faits aussi caractérisés, il est étonnant qu’ils n’aient été condamnés qu’au mois de mars et que, à la différence de Lemoine, leur cas, semblable : tentative d’assassinat d’un cadre, ait été soumis à arbitrage présidentiel. La réponse a été lente à arriver : refus pour Godot le 24 mai et pour Cadot le 18 juin, entraînant leurs exécutions respectivement le 25 mai et le 20 juin.
Deux destins similaires:
Les deux derniers exécutés de la cohorte de mars l’ont été côte à côte, le 4 mai à Montigny, dans la Marne. Ils appartenaient au 82e RI, régiment formé essentiellement de recrues parisiennes, ce qui était leur cas. Gouailleurs, prompts à railler l’autorité et à n’en faire qu’à leur tête, ils avaient connu fréquemment les locaux disciplinaires. Marcel Daubignard, 30 ans, carreleur à St-Ouen, avait commencé très tôt, lors de son service militaire de 1907 à 1910, puisqu’à sa sortie il totalisait 113 jours de salle de police, 31 jours de prison et 16 jours de cellule.
Voici quelques spécimens des motifs :
Il n’avait été libéré qu’en novembre 1910 car il avait pris un an de prison en mars 1908 pour une désertion de trois mois, bénéficiant de la remise du restant de sa peine en décembre. Rappelé en 1914, le Conseil de Guerre de Paris le condamnait le 16 janvier 1915 à 3 ans de travaux publics, pour une désertion passée chez lui à St Ouen, d’où il s’était constitué prisonnier. Sa peine suspendue, il était à nouveau condamné, le 8 mars 1915, toujours à Paris, pour un abandon de poste, à 2 ans de prison. Cette 2ème condamnation annulait la suspension précédente et il était dirigé, en avril, sur l’atelier de travaux publics de Bougie en Algérie. Après une nouvelle suspension obtenue fin août 1916, il était arrivé au front au 82e RI le 3 octobre. Le 13 octobre, il disparaissait.
Auguste Defis, 26 ans, photographe à Vincennes, avait un parcours aussi chaotiquement semblable. Entre son passage sous les drapeaux et son jugement, ce sont 27 jours de salle de police, 169 jours de prison et 42 de cellule qui sont à mettre à son actif.
Comme pour Daubignard, rien de violent chez lui mais des fautes contre la discipline :
En service de 1911 à fin 1913, il avait vite retrouvé l’uniforme.
Le 10 mai 1915, le Conseil de Guerre de la 10e Armée le condamnait à 10 ans de travaux forcés pour refus de marcher contre l’ennemi. Peine suspendue, il arrivait au 82e RI fin juillet 1915. Il abandonnait son poste à Verdun le 25 novembre 1916, partait pour Paris retrouver sa famille. A Paris, il finissait par se constituer prisonnier le 2 janvier. Ecroué au régiment, seulement le 10 février, il s’échappait le 20, repartait en famille et se reconstituait à nouveau prisonnier à Paris le 2 mars.
Durant l’enquête, il ne fit pas de difficulté pour reconnaître sa désertion et l’assumer :
Il faut noter sa tranquille assurance, s’étant persuadé qu’à partir du fait qu’il était hors de contact de l’ennemi, il risquait peu, persuadé que sa désertion n’avait pas eu lieu en présence de l’ennemi.
Pour abandon de poste et double désertion, il comparaissait, en compagnie de Daubignard, devant le Conseil de Guerre de la 9e DI, le 13 mars 1917, le dossier rapidement ficelé.
Quant à Daubignard, déserteur du 13 octobre, il était rentré chez lui à St Ouen, où il avait été arrêté le 31. Ecroué, on lui avait dit de rejoindre sa compagnie le 16 novembre, en partance pour les casernes Bevaux à Verdun. Il disparaissait encore une fois et était arrêté à nouveau chez lui le 25 décembre.
Son point de vue était assez semblable à celui de Defis :
Cette défense désinvolte a été mal appréciée par son commandant de compagnie :
Quant au chef de corps, ces deux prévenus sont tout ce qu’il abhorre et il donne le même conseil pour les deux.
Avis sur Daubignard :
Avis sur Defis assez semblable :
Malgré cette animosité du colonel, les juges ont demandé la grâce. Il y a un doute sur cette demande spontanée des juges pour Daubignard car il y a trace d’une intervention présidentielle pour l’imposer :
Le 18, le Conseil de révision n’avait pas encore statué. Il l’a fait le 19 en confirmant la condamnation. Il a dû recevoir aussi en urgence le télégramme présidentiel, si l’on en croit la précaution qu’il a prise :
On ne sait qui a alerté le Président.
L’examen du dossier au Ministère de la Guerre a amené finalement ses fonctionnaires à confirmer la sentence, proposition entérinée par la Commission des grâces, sensible à la position du Commandement :
En foi de quoi le 2 mai, la Présidence donnait son feu vert pour Daubignard, ainsi d’ailleurs que, ce même jour, pour Defis et 48 heures après la double sentence était exécutée.
Une "sortie" lourde de conséquences:
La majorité de la cohorte du mois a évité la mort comme Poilpré et Guernstein.
Le 30 novembre 1916, vers 18h00, les soldats Poilpré et Guernstein de la 2e compagnie du 176e RI s’étaient constitués prisonniers au dépôt intermédiaire du régiment à Zeitenlick. Ils avaient quitté, sans autorisation, le régiment depuis le 21 novembre. Ces militaires ont été internés à Salonique au camp de Zeitenlick, la 2e compagnie du régiment occupant une position aux environs de Slivnica au Nord-Ouest de Krani en Serbie.
La 2ème compagnie occupait la première ligne. A l’appel de 6h00 du matin du 22 novembre, Poilpré et Guernstein étaient manquants. Les 2 soldats avaient emporté leurs armes, équipements et vivres.
Le soldat Guernstein fournissait des explications lors de l’interrogatoire des accusés.
Le soldat Poilpré fournissait également des explications.
Poilpré expliqua qu’il voulait faire la « bombe » avec son argent. Pour lui, il n’avait pas abandonné son poste, la compagnie était bien en 1ère ligne mais il n’était pas en sentinelle.
Les témoins étaient interrogés à leur tour.
Le soldat Lavache témoigna sur Poilpré :
Les soldats Robin, Adler et Engelibert, témoins, avaient tenu le même genre de propos : les soldats avaient été prévenus de l’attaque le matin même ; dès la distribution de pain faite, Poilpré et Guernstein sont partis en direction du village de Krani. Guernstein aurait déclaré au soldat Engelibert : si je savais le bulgare, je ferais comme lui (référence à un soldat bulgare qui avait déserté et s’était présenté devant les lignes françaises une cigarette à la bouche).
Dans leurs déclarations, Poilpré et Guernstein exprimèrent les plus vifs regrets pour leurs fautes.
Le commissaire-rapporteur demanda la traduction de ces 2 militaires devant le Conseil de Guerre de la 156e division pour abandon de poste en présence de l’ennemi en application de l’article 213 du code de justice militaire.
Dans les notes d’audience, le greffier a noté la bonne attitude des 2 accusés mais également leurs protestations lors de la lecture des dépositions des témoins.
Le 28 janvier 1917, le Conseil de Guerre de la 156e DI a condamné à la peine de mort les soldats Poilpré et Guernstein, lesquels s’étaient pourvu en révision. Le 1er février, un recours en grâce a été signé par les membres du Conseil de Guerre en faveur des condamnés à mort.
Le 15 février, le Conseil de révision de l’Armée d’Orient s’était réuni pour statuer sur le pourvoi de ces soldats. Le Conseil déclara que : conformément à l’article 22 du code de justice militaire, nul ne peut faire partie d’un Conseil de Guerre à un titre quelconque s’il n’est pas français ou naturalisé français et âgé de 25 ans. Comme un des juges n’avait pas les 25 ans requis et sur l’absence de débat oral lors de la séance, le Conseil de révision a cassé et annulé le jugement prononcé par le Conseil de Guerre de la 156e DI.
Le 6 mars, le Conseil de Guerre de la 16e DIC s’était réuni pour rejuger Poilpré et Guernstein pour abandon de poste en présence de l’ennemi. Les mêmes témoins étaient convoqués, seul manquait le caporal Adler soigné pour maladie à l’hôpital temporaire n°8. Dans les 5 pages des notes d’audience, Guernstein a reconnu avoir quitté la compagnie, avoir rejoint Poilpré sur la route de Krani, être monté dans le train en gare de Florina. Nous voulions aller nous amuser avec l’argent que nous possédions l’un et l’autre indiqua Guernstein qui déclara ignorer la gravité de sa faute et la regrettait. Poilpré souligna : il est exact que j’ai abandonné ma compagnie, Guernstein m’a rejoint sur la route de Krani vers 5h30, nous avons pris le train à Florina et nous sommes allés à Salonique. Poilpré expliqua que le soldat Lavache n’avait pas bien compris ses propos. Là aussi, le greffier a noté la bonne attitude des 2 accusés.
A l’issue des débats, le Conseil de Guerre de la 16e DIC a condamné les soldats Poilpré et Guernstein à la peine de mort. A l’issue de ce second jugement, Poilpré et Guernstein ne s’étaient pas pourvus en révision.
Sur avis favorable du général commandant en chef les Armées alliés en Orient transmis au Ministère de la Guerre, le 14 mai 1917, le Président de la République a commué les peines de mort prononcées en 20 ans de prison.
Le soldat Guernstein a été incarcéré à la maison centrale de Nîmes. Le 15 septembre 1919, le Président de la République lui a accordé la remise de la moitié de sa peine. Guernstein a été élargi le 15 décembre 1921, dirigé vers le 96e RI ; il a été renvoyé dans son foyer le 26 janvier 1922.
Incarcéré à la maison centrale de Nîmes, le 22 décembre 1920, Poilpré a reçu une remise de 5 ans de sa peine. Le 14 janvier 1922, par décision n°7474 du Ministre de la Guerre du 17 décembre 1921, l’exécution de sa peine a été suspendue.
Cette « sortie » à Salonique pour « faire la bombe» a failli leur coûter cher, du fait de leur départ la veille d’une attaque et de leur réputation de « tire-au-flanc». Pour le reste, on a bien quitté « l’énergique célérité » du début de la guerre. Disparus le 22 novembre 1916, leur cas va occuper la Justice militaire durant 7 mois. Ils ne sont jugés que le 28 janvier, jugement annulé le 15 février, recondamnés le 6 mars avant commutation de la peine de mort en 20 ans le 14 mai.
4- Cohorte d’Avril : 9 condamnés à mort, 1 exécuté, 7 commutations de peine, un jugement annulé pour vice de forme par les conseils de révision d’armée, sur les 7 examinés.
Neuf condamnés à mort, un pourvoi en révision accepté sur 7 demandés, 7 grâces demandées, toutes acceptées. C’est ce mois qui détient le nombre de condamnés à mort le plus faible de 1917. On dénombre un fusillé, Petitjean, le seul dont le dossier n’a pas été transmis.
Il s’agit du dernier mois avant la mise en œuvre de la transmission obligatoire des dossiers. On s’aperçoit que dans la pratique, on est quasiment arrivé à ce résultat en amont de la publication de la circulaire ministérielle du 20 avril 1917. Elle ne révolutionnera donc pas la pratique. La grâce, chose rare, a été systématique ce mois-là pour les condamnations aux armées. Les quatre demandes de grâce pour militaires à l’arrière ont toutes été rejetées : un assassin, trois traîtres. Les procédures sont au point. Ainsi le dossier de Georges Ausilia, condamné le 19 avril pour un abandon de poste, pourvoi rejeté le 30, est dirigé, via le GQG, vers la cellule parisienne de la Justice Militaire. Celle-ci informe la Direction des Grâces de ses propositions le 28 mai. Le Garde des Sceaux signe son accord le 31 mai. Le décret présidentiel sort le 4 juin avec une commutation en 20 ans de prison. Si la cellule « Guerre », semble prendre un certain temps dont il faut défalquer celui mis par les diverses autorités hiérarchiques pour inscrire leur avis, le passage à la Direction des Grâces est rapide, ainsi que l’entérinement à la Chancellerie élyséenne.
Qu’est ce qui a valu à Petitjean d’être le seul fusillé de la cohorte d’avril ?
Les voies de fait envers un supérieur pendant le service ont été assez fréquentes au cours de ce conflit. Le dossier du soldat Petitjean illustre ce type de « crime » sanctionné par l’article 223 du code de justice militaire. La liste ci-dessous présente les condamnations antérieures du soldat Petitjean.
Pour les 2 dernières condamnations, Petitjean avait bénéficié d’une remise de peine et d’une suspension de peine.
En 1917, sa remise de peine d’un an de travaux publics sur les 5 écopés au Conseil de Guerre de Tunis en mars 1914 le maintenait sous cette juridiction encore pendant un an.
En 1917, il n’avait encore jamais vu le feu. Les Ateliers de Travaux Publics fonctionnant jusqu’en 1916 exclusivement en Afrique du Nord, il avait passé tout ce temps (1914-1916) en Algérie. Son arrivée en métropole était due à la décision ministérielle de l’automne 1916 de déplacer certains de ces Ateliers sur le front, avec leurs détenus, armés de pioches et pelles, pour effectuer les travaux salissants et dangereux. Cela répondait à l’idée qu’on ne pouvait laisser, sur le plan du moral, les indisciplinés à l’arrière et les bons soldats au danger.
Une note du fin janvier 1917 avait le point sur ce processus en cours :
Petitjean a suivi le déplacement de son atelier, le numéro 2. Non endivisionnée, cette unité était rattachée pour la discipline au QG de l’Armée sur le territoire de laquelle elle était implantée.
C’est pour cela que le 14 avril, à Bar-le-Duc, Petitjean comparaissait devant le Conseil de Guerre du Quartier général de la 2e Armée. Pour quelles raisons ?
Selon le rapport du commissaire-rapporteur Cuaz, à Brocourt, le 11 mars, les sergents Chiraussel et Desumeur conduisaient le soldat Delhommeau dans une cellule où étaient incarcérés des détenus dont Petitjean. Ce dernier injuria les sous-officiers en les traitant de « vaches, buveurs de sang », ajoutant qu’il tuera le premier qui rentrerait. Posté près de la grille d’entrée de la cellule, Petitjean lança des pierres, Desumeur parvint à faire rentrer Delhommeau « ami plus qu’intime » de Petitjean et rendit compte au commandant de l’atelier.
Vers 17h00, le sergent Chiraussel, sergent de semaine accompagné du lieutenant Suchaud, des sergents Baignon, Désumeur, Rousse, Boule, de 4 gardes, donnait l’ordre aux 18 détenus de sortir de cellule pour l’appel du soir. Tous sortirent du local sauf Petitjean. Celui-ci jeta des pierres dont une toucha Chiraussel à la tête. Chancelant et aveuglé par le sang, le sergent tira 4 coups de revolver sur Petitjean sans le toucher, Chiraussel fut porté dans sa chambre pour être pansé puis fut conduit à l’hôpital de Bar-le-Duc sur ordre du médecin, le sergent ayant une plaie de 4 cm au niveau de l’arcade sourcilière droite. Le sergent Baignon, qui prit la suite de Chiraussel, fut également accueilli avec des jets de pierres. Petitjean s’approcha alors de Baignon pour tenter de mieux le frapper mais celui-ci lui tira une balle dans la cuisse qui le blessa « très légèrement ». Petitjean maîtrisé, les militaires purent vérifier l’état de la cellule pour éviter les évasions.
Petitjean était en prison depuis la veille sur la requête du rapporteur du Conseil de Guerre qui menait une enquête sur une affaire de « pédérastie » où il était impliqué. Le lieutenant Suchaud soupçonne Delhommeau se s’être fait volontairement incarcéré pour rejoindre Petitjean.
Le rapport du commissaire-rapporteur était très défavorable ; il indiquait que Petitjean était un individu excessivement dangereux, d’une moralité déplorable. Il déposa une plainte en demandant sa comparution devant un Conseil de Guerre pour voies de fait et outrages envers des supérieurs pendant le service. Son défenseur était le soldat Deville, avocat dans le civil.
Les protagonistes ont été entendus par le commissaire-rapporteur sauf le lieutenant qui était soigné à l’hôpital pour maladie comme l’indique le certificat du médecin-chef.
Les déclarations des détenus Jézequel et Blineau ne sont pas très précises.
Le sergent Baignon fournit sa version des faits :
Durant son interrogatoire, Chiraussel précisait qu’il avait été soigné à l’hôpital de Bar-le-Duc :
Les déclarations du sergent Désumeur sont similaires à celles des sergents Baignon, Chiraussel et Rousse.
Interrogé par le lieutenant Suchaud, en tant qu’officier de police judiciaire, Petitjean refusa de répondre aux questions. Par contre, durant son interrogatoire par le commissaire-rapporteur, Petitjean fournit sa version des événements. Vers 16h00, il aurait manifesté sa désapprobation envers les procédés des sous-officiers qui auraient maltraité Delhommeau. Le sergent Désumeur lui aurait dit : ça va être ton tour, tout à l’heure. Ce dernier aurait donné son révolver au sergent Chiraussel pour le tenir en joue pendant que Désumeur ouvrait la porte de la cellule. Petitjean affirma qu’il pensait qu’il allait être mis aux ficelles et passé à tabac, il refusa donc de sortir, Désumeur lui aurait jeté des pierres et Chiraussel lui aurait tiré une balle entre les jambes sans le toucher. Petitjean continua son récit en précisant que ¾ heure plus tard, le lieutenant commandant de l’atelier et les sous-officiers seraient revenus en ordonnant aux prisonniers de sortir ce qu’ils firent tous sauf lui. Le lieutenant aurait donné l’ordre aux sous-officiers de sortir leurs révolvers et d’aller le chercher. Chiraussel aurait tiré 5 balles dont une qui le blessa à la cuisse. Petitjean aurait alors jeté des pierres et Chiraussel serait parti pour un motif qu’il ignore. Les sergents Désumeur et Alfonsi auraient tiré 12 balles, le lieutenant aurait également tiré une balle mais aucune ne l’aurait touché. Le lieutenant aurait ordonné d’aller chercher des couvercles de marmite pour se protéger, de la paille pour l’enfumer et aurait ordonné à 2 détenus de le faire sortir en indiquant « je lui donne 2 minutes pour réfléchir, je veux te sortir d’un mauvais pas ». Selon sa déposition, Petitjean aurait obtempéré, se serait couché, on l’aurait attaché 48 heures au pied d’un arbre.
Le médecin aide-major de 1ère classe qui a examiné la blessure de Petitjean, a déclaré que la plaie concernait seulement la peau et la couche sous-jacente. En ce qui concerne la blessure de Chiraussel, le médecin indiqua la peau, les muscles et peut-être l’os frontal étaient atteints.
Les notes d’audience reflètent ces divergences entre les dépositions des témoins et des accusés.
Après la lecture des pièces du dossier et des questions posées aux témoins et à l’inculpé, les juges, en répondant oui aux 8 questions posées, ont condamné à l’unanimité le soldat Petitjean à la peine de mort en application des articles 223, 224, 135, 139, 187 du code de justice militaire et de l’article 9 de la loi du 22 juillet 1867. Les juges n’ont pas accordé les circonstances atténuantes dans ce dossier.
Petitjean s’était alors pourvu devant le Conseil de révision mais attendu que le Conseil de Guerre était compétent et constitué conformément à la loi, que la procédure est régulière et que la peine a été bien appliquée aux faits légalement qualifiés et déclarés constants, le pourvoi a été rejeté le 18 avril. Dans ce dossier, il est bien mentionné qu’aucune demande de grâce n’a été adressée par les juges à la Présidence de la République. Cette pièce du dossier, datée du 20 avril précise : attendu qu’après examen de la procédure, nous estimons qu’il n’y a pas lieu de provoquer, en faveur du condamné, une mesure exceptionnelle.
Ironie de l’histoire, c’est ce 20 avril qu’était publiée la lettre ministérielle mettant fin à la notion de l’exceptionnalité du recours en grâce auprès du Président de la République, ce dernier redevenant le seul décisionnaire en la matière.
Le 20 avril, à Rampont, le médecin-chef Brunel commis à cet effet a constaté le décès de Petitjean.
Dans ce dossier, les déclarations des protagonistes sont contradictoires. Le sergent Baignon déclara avoir blessé Petitjean alors que ce dernier affirma que c’est Chiraussel qui aurait tiré. Petitjean a reconnu avoir lancé des pierres mais il affirma ne pas savoir si c’est lui qui a blessé Chiraussel. On se demande pourquoi Chiraussel aurait lancé des pierres à Petitjean pour le faire sortir de la cellule alors qu’il était accompagné de 4 autres sergents et de 4 gardes, et que 2 détenus avaient l’ordre de faire sortir Petitjean. On se demande également comment Petitjean n’aurait pas été, ou si peu, blessé avec le nombre de balles tirées selon lui lors de son extraction, nombre de tirs qui n’est pas corroboré dans les pièces du dossier alors que les 5 premiers tirs sont bien mentionnés.
Le Général en Chef incline vers la clémence:
Le 20 mars 1917, la 11e compagnie du 173e RI tenait les tranchées de la 1ère ligne à la lisière du bois des Caurières au Nord-Est de Douaumont. Depuis mai 1916, le 173e était dans le secteur de Verdun changeant de zone : la cote 304, la côte du Poivre, la cote 344, il y restera jusqu’en octobre 1917. La 3e section était appelée à son tour à tenir la première ligne. L’installation terminée, le sergent Bouvard signala alors au capitaine Santini commandant de la compagnie, que le soldat Chazette n’avait pas suivi son escouade en profitant de l’obscurité pour probablement retourner à l’abri où la section avait passé la journée précédente. Le capitaine envoya un agent de liaison, le soldat Guinard, pour donner l’ordre à Chazette de rejoindre sa section. Chazette déclara à Guinard qu’il allait la rejoindre. Deux heures plus tard, Chazette n’avait toujours pas rejoint sa section. Guinard retourna une 2ème fois puis une 3e fois. Le trajet entre la 1ère ligne et l’abri étant dangereux, lorsque Guinard revint chercher Chazette la 3ème fois fois, Guinard le prévint : je ne voudrais pas me faire casser la gueule pour toi, si je suis obligé de revenir te chercher encore une fois, je te rentre dedans. Impressionné Chazette s’équipa, quitta l’abri, fit semblant de rejoindre sa section et disparut. Il resta introuvable pendant tout le séjour de la compagnie en 1ère ligne. Il ne la rejoignit que le 23 mars, lorsqu’elle quitta la 1ère ligne pour aller au repos à 2 km des lignes ennemies.
Le capitaine Santini demanda la comparution de Chazette devant le Conseil de Guerre de la 126e Division pour abandon de poste en présence de l’ennemi. Les témoins cités à comparaître sont le sergent Claver et le soldat Guinard, le sergent Bouvard ne pourra pas témoigner, il avait été tué au champ d’honneur.
Le capitaine Massoni est chargé d’instruire la plainte contre Chazette. Celui-ci n’a été condamné qu’une fois pour vol en 1910. Le 9 avril, il a été écroué à la prison militaire de la division. Chazette était noté comme « mou et sans courage ».
Interrogé, Chazette avait tenté de se justifier :
Le sergent Claver témoigna :
A son tour, le soldat Guinard donna son témoignage :
Le 11 avril, le Conseil de Guerre de la 126e DI s’était réuni à Verdun à la caserne Bevaux. Aux 3 questions posées aux juges, ceux-ci ont répondu : oui sans admettre les circonstances atténuantes et ont condamné Chazette à la majorité de 4 voix contre une, à la peine de mort en application des articles 213, 187, 139 du code de justice militaire.
Chazette s’était pourvu en révision mais le Conseil de révision, dans sa séance du 18 avril, a rejeté le recours formé par le condamné.
A l’unanimité, les juges ont signé le recours en grâce. Dans le dossier 2840 S17 des archives du Ministère de la Justice, on trouve cette remarque au sujet de Chazette : les généraux de Corps d’Armée et d’Armée estiment que malgré son jeune âge, Chazette ne mérite aucune pitié. Les autres autorités hiérarchiques, général en Chef compris inclinent vers la clémence. La « guerre » conclut à la commutation en 15 ans. Le rédacteur du Ministère de la Justice poursuit : proposition d’adhérer. La conclusion de la « justice »est : vu et approuvé.
Le 22 mai, le Président de la République a commué la peine de mort requise contre Chazette.
Détenu à la maison centrale de Nîmes pour y purger sa peine, Chazette a obtenu le 10 novembre 1920 une remise de 4 ans de prison sur les 15 ans. Le 12 janvier 1921, Chazette a obtenu une 2ème remise de 5 ans de prison. Le 28 septembre 1921, Chazette a obtenu une dernière remise de 5 ans de prison. Le 26 octobre 1921, Chazette était libéré.
Pour quelle raison les juges ont-ils signé le recours en grâce de Chazette ? Difficile à dire par rapport à d’autres cas similaires : Krief, Kilani, Mayet en février, auxquels elle a été refusée et qui ont été exécutés. Quand la demande a été faite en février pour Varain, la commutation a été accordée. Ce type de faute a-t-il été considéré à Paris comme non justiciable d’exécution capitale ? Prisme va essayer de voir sur les mois suivants si cette tendance se concrétise.
Il est bon de s’arrêter sur les bilans de ce quadrimestre, dernier à fonctionner avec la procédure de la demande de grâce ou de commutation des peines, à la disposition des juges et du Commandement. On peut noter une tendance générale. Ainsi janvier semble se rapprocher des errements des années antérieures avec un nombre conséquent de condamnés à mort : 46, 8 rejets de grâce et 12 fusillés dont 4 sans sollicitation de grâce. En février, la conjonction de la révision et des grâces a abouti à ce que de 14 condamnés à mort, on est arrivé à 3 exécutés. En mars, avec un nombre de condamnés plus important, 23, on n’arrive qu’à 5 exécutés. Deux ont vu leur jugement annulé, 20 sur 21 ont été bénéficiaires d’une demande de grâce, dont 2 rejetées en métropole et 2 au Maroc sur décision du Résident Général. En avril, la tendance a été la même, à savoir la demande de grâce quasi systématique.
Sur les 21 exécutés du quadrimestre dont 4 en Afrique du Nord, près de 57% l’ont été en janvier. Dans les trois mois qui suivent n’ont eu lieu que 9 exécutions, dont 4 pour tentative d’homicide par arme à feu et une pour voie de fait sanglante.
Il est temps de voir maintenant quels ont été les changements, s’il y en a eu, provoqués par l’application de la lettre ministérielle du 20 avril 1917 qui enlevait définitivement au commandement la prérogative obtenue en début de guerre de faire ordonner des exécutions de condamnés à mort sans avoir à en demander la permission au politique. L’événement, inattendu de la strate politico-militaire, qu’a été l’explosion des mutineries va mettre à rude épreuve le processus en cours d’une justice, en voie d’humanisation et de garanties pour les accusés, et subitement confrontée au spectre d’une désobéissance collective, suspectée par certains d’être révolutionnaire et susceptible de menacer les institutions.
Prisme va continuer à analyser, pragmatiquement et successivement les 8 mois restants de l’année en gardant en tête les deux faits structurants de cet espace de temps : la prise de contrôle du politique sur le droit de vie et de mort des citoyens-soldats et la menace des mutineries.
5- Cohorte de Mai : 34 condamnés à mort, 5 exécutés, 23 commutations de peine, 6 jugements annulés pour vice de forme par les conseils de révision d’armée, sur les 33 examinés.
Au niveau des proportions, le mois de mai se singularise peu ou pas par rapport aux mois précédents, sauf que tous les dossiers ont été transmis. Sur les 5 fusillés, deux l’ont été en Afrique du Nord.
Frencia, du Bataillon Territorial de la Chaouia, a tenté de tuer son adjudant pour s’emparer de ses économies le 12 mars 1916 à El Boroudj au Maroc. Condamné à mort le 18 mai, il a attendu le 31 juillet pour apprendre la décision présidentielle négative suite à la transmission de son dossier le 25 juin. Il était fusillé à Casablanca le 2 Août à 6h00.
Sylvain Lacherade, engagé volontaire pour 4 ans en 1909 était titulaire de 5 désertions avant 1914, ce qui l’avait amené à être affecté en 1915 au 4e BILA. A sa nouvelle désertion, il avait été envoyé, en octobre 1916, dans une unité du 5e Bila faisant partie, dans le Sud Tunisien, de la garnison d’un fort régulièrement harcelé par des irréguliers : Dehibat. Il s’en échappait le 12 décembre 1916 en compagnie de Lucien Fabre. Moins chanceux que ce dernier, il avait été rattrapé. Jugé le 23 mai pour « abandon de poste en présence de rebelles armés », jugement confirmé par le Conseil de révision le 1er juin, il était exécuté le 3 Août à 6h00 à Médenine, le Président de la République ayant « laissé la justice suivre son cours ».
Sur le front Nord-Est, la cohorte de mai n’a fourni que 3 fusillés.
Pour Désiré Heuls, la conviction du commissaire rapporteur dans ses conclusions du 12 mai 1917 est nette :
En ressort l’image d’un homme qui serait calculateur et dont les antécédents judiciaires le font soupçonner d’être incorrigible. Heuls s’est bien constitué prisonnier à peine arrivé à Paris :
A-t-il pensé, comme on le lui prête, éviter de participer à une attaque sans risque pénal pour lui ?
A l’audience, le 18 mai, il donnera une motivation sans ambiguïté :
En foi de quoi, il a été condamné à mort avec refus des circonstances atténuantes à 4 contre 1, jugement confirmé en Conseil de révision le 2 juin et grâce rejetée le 27 juin avec exécution 48 heures après le 29.
Ses condamnations antérieures : « professionnel de la désertion », lui ont été fatales :
Au même régiment, le 43e RI, le 16 avril, un jour avant Heuls, un autre soldat commettait le même type d’abandon de poste mais lui n’était pas fusillé.
L'importance de l'avis des juges:
La 9e compagnie devant s’élancer à 6h40, ordre fut donné aux hommes de s’équiper et de se préparer à l’attaque. C’était le 16 avril, le 3e bataillon du 43e RI occupait la 2e ligne d’où devait partir directement l’assaut du plateau de Vauclerc. La 2e section dont fait partie le soldat Fernez, était abritée, en attendant l’heure de départ, dans une sape à l’extrémité sud du boyau 10 près de Craonnelle.
Vers 5h15, le commandant de la compagnie était prévenu que Fernez venait de s’esquiver sous prétexte d’aller chercher de l’eau. On le fit rechercher mais en vain. Fernez ne put être retrouvé, ne reparut plus à la compagnie avant le 24 avril à Baslieux-lès-Fismes. Suite à ces évènements, le chef d’escadron Marthe déposa donc une plainte contre Fernez.
Fernez avait été l’objet d’une plainte en Conseil de Guerre en octobre 1916 au 127e RI pour des faits similaires. Le commissaire-rapporteur souligne que sa conduite fut analogue dans la Somme en septembre 1916 où il ne dut qu’aux circonstances et à l’indulgence du colonel commandant le régiment, de n’encourir qu’une peine disciplinaire. Fernez avait été envoyé en section de discipline où il resta jusqu’en janvier 1917.
Fernez a été écroué à la prison du QG de la 162e DI le 8 mai.
Le 20 mai, le commissaire-rapporteur décida de déférer Fernez devant le Conseil de guerre pour avoir commis dans les environs de Craonnelle (Aisne) un abandon de poste en présence de l’ennemi.
Témoignage du caporal Cornette :
Témoignage du capitaine Caulliez :
Témoignage du caporal Picavet :
Fernez s’expliqua :
Comme son camarade Heuls, il donne comme motivation de son abandon de poste, la peur.
Le 29 mai, le Conseil de Guerre de la 162e DI, dix jours après la condamnation de Heuls, s’était réuni pour juger le soldat Fernez. A la majorité de 3 juges contre deux, Fernez a été condamné à la peine de mort en application du fameux article 213 & 1 du code de justice militaire. Le même jour, Fernez s’était pourvu en révision. Le 8 juin, le Conseil de révision de la 4e Armée a rejeté son pourvoi.
A l’unanimité, les juges ont signé le recours en grâce, une pratique donc parfois encore usitée un mois après la parution de la circulaire du 20 avril 1917. Il est vrai que ce processus n’a pas été formellement abrogé dans la circulaire et que rien n’empêchait de le faire coexister avec les nouvelles directives. Ce recours peut même s’avérer comme un argument décisionnel pour la direction des affaires criminelles et des grâces.
Le 8 juillet, sur le rapport du Ministre de la Guerre et après l’avis du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Président de la République a commué la peine de mort requise contre Fernez en 20 ans d’emprisonnement. La « justice » a considéré que sa constitution malingre et le recours signé par tous les juges inclinait vers une mesure de clémence, la condamnation n’ayant été obtenue que par 3 juges contre deux. Fernez a été écroué à la maison centrale de Fontevrault où il décéda le 15 octobre 1918.
On a pu observer combien les cas Heuls et Fernez étaient semblables, même pour les condamnations antérieures. La différence tient ici à l’aspect malingre du condamné mais surtout à la décision prise à 3 contre deux et à l’initiative des juges de signaler leur souhait de commutation. Reste que sur le plan des faits, semblables, nous avons, initialement, deux comportements et jugements de Conseils de Guerre différents.
Le Président de la République laisse la justice suivre son cours:
René Samuel Levy, lui, n'a pu s’extirper des conséquences d’une première condamnation le 6 octobre 1914. Soldat au 151e RI, il avait pris 20 ans de prison ce jour-là pour abandon de poste et vol dans une maison abandonnée fin août-début septembre. Sa peine, purgée à la Centrale de Clairvaux, était suspendue au bout de 18 mois avec obligation d’engagement aux Bat d’AF. Il avait retrouvé le front le 10 mars 1916 au 3e BMILA. Le 26 janvier, il partait en permission pour 7 jours à Paris et décidait de ne pas rentrer. Aux gendarmes, qui l’arrêtaient le 24 mars, il déclarait qu’il était parti car, à son unité, « il était trop malheureux ». En attente de jugement, il avait été mis à la Section de discipline de la Division. Les sections de discipline étaient alors en train de se mettre en place. L’idée en remontait à janvier 1915.
L’enthousiasme n’avait pas été général, car cela supposait pour les corps de nouvelles contraintes :
L’intérêt résidait dans le fait que la décision d’envoi dans ces unités était dans la main du commandement. Un conseil de discipline, composé de trois officiers du régiment, en décidait souverainement. Le Ministère de la Guerre en octobre 1915 s’était contenté de normaliser la pratique au front.
Enfin, par circulaire n° 9.412 du 13 août 1916, le GQG avait autorisé, sous réserve de lui en rendre compte, la création facultative de Sections de Discipline (S.D.) dans les Divisions.
Les critères d’envoi étaient assez flous.
Voici comment la 97e Division d'Infanterie Territoriale l’avait présentée, à sa création en novembre 1916 : « Une section de discipline est créée à la 97e DIT. Y seront envoyés, très prochainement, les quelques rares individus, tarés, condamnés, ivrognes, qui, la plupart venus de corps étrangers, font tache au régiment qui ne se compose que d’honnêtes gens »
René Lévy en avait donc (comme Rostagni jugé en janvier 1917) bénéficié. Le 11 septembre 1917, le général Pétain prendra soin de préciser les critères d’envoi « suite aux dérives constatées » :
« Ces formations sont destinées à réunir, dans des groupements spéciaux, les hommes dont l'inconduite habituelle est d’un exemple pernicieux pour leurs camarades des Corps de troupe, mais qui cependant sont susceptibles de s’amender » [..]
Les erreurs d’affectation les plus fréquemment relevées sont les suivantes :[..]
« Affectation d'office aux Sections de Discipline de tous les hommes qui ont été traduits devant un Conseil de Guerre. Cette affectation d’office doit être écartée. Quelle que soit la situation d’un homme à la suite de sa comparution devant un Conseil de Guerre, acquittement, sursis, suspension de peine, cet homme doit être versé dans un Corps de troupe »
Levy, en attente de Conseil de Guerre, n’avait donc pas fatalement sa place en S.D. Ces S.D. étaient soumises à un travail incessant et éreintant censé leur amener l’idée de raccourcir au plus vite leur séjour « en s’amendant ».
Ainsi, la nuit du 5 avril 1917, Lévy et ses congénères, transportaient, du dépôt au front, de lourdes torpilles de Crapouillots, dits d’Artillerie de tranchée, en vue de l’offensive du 16 avril, sous des tirs de barrage adverses. En plein milieu de cette corvée, après altercation avec son chef sur sa fatigue, Lévy avait disparu. Il était arrêté à Bordeaux le 24 avril. Il ne s’agissait plus, comme la première fois d’une désertion simple mais d’un abandon de poste en présence de l’ennemi. Il était condamné à mort le 18 mai, jugement confirmé en révision le 25, avec dans la foulée transmission de son dossier à Paris. A cette occasion, la cellule chargée de l’examen ne travaillait pas que sur dossier et pouvait poursuivre l’enquête sur ce qui lui paraissait obscur.
Les précisions fournies n’empêchèrent pas la Présidence de la République d’autoriser le 9 juillet l’exécution qui eût lieu le 13 du même mois.
Quels ont été les critères de choix à Paris ?
Le rédacteur de la Direction des Grâces a été assez enclin, sur le plan formel, de relever une des raisons soulevées par la « Guerre » : la perte d’exemplarité de l’exécution trois mois après la sentence, raison qui ne porte pas sur la nature de la faute, mais sur l’effet qu’on recherche, pour proposer de surseoir. Son supérieur hiérarchique a fermé cette ouverture.
Un "sacré" personnage:
Avec Edouard LOUIS, on s’approche d’un personnage de roman. Engagé volontaire en 1909 dans la cavalerie, il avait commencé par déserter en 1911 et fait connaissance avec le Conseil de Guerre qui lui infligea un an avec sursis. Quatre mois plus tard, il comparaissait à nouveau le 11 décembre 1911 pour complicité de vol et écopait d’un an de prison. Libéré après 6 mois, par réduction de peine, il allait finir son temps d’engagement au 5e Bila, en tant qu’auteur d’un délit de droit commun. A la mobilisation, il rejoignait, en tant qu’ancien Bat d’Af le 4e Groupe Spécial à Mamers. Il le quittait pour le 115e RI puis le 8e RI. A peine arrivé à ce nouveau régiment, au cours d’une attaque le 7 juin 1915, il se distinguait, était nommé sergent sur le champ de bataille et décoré dans les jours suivants de la Croix de Guerre. Bien vu, il obtenait directement de son colonel le 16 septembre un sauf-conduit de quelques jours pour négocier un mariage par procuration. Le régiment perdait sa trace avant de le récupérer en octobre. Ayant rejoint son dépôt du 4e Groupe Spécial à Mamers, il y avait été arrêté et mis en prévention du Conseil de Guerre permanent de la 4e Région pour désertion à l’intérieur et avait réussi à obtenir un non-lieu le 30 novembre. Il rejoignait son régiment le 8 décembre et était cassé de son grade sur le champ.
Le commissaire rapporteur expose :
Commence alors une longue cavale résumée sur le plan moral par le Commissaire rapporteur :
Arrêté, ramené, un ordre d’informer était signé à son encontre le 10 octobre. Hospitalisé le 13 pour soupçon de gale, il s’échappait le 30 octobre 1916 près d’un an après son abandon de poste de décembre 1915.
On imagine la rage du commissaire rapporteur devant cet homme « portant beau » et prodigieux bonimenteur, qui, en désertion n’avait cessé de commettre des méfaits.
La lettre du Commissaire de police de Saint Nazaire du 10 juillet 1916 en fait foi :
Il était à nouveau arrêté à Paris le 22 novembre et incarcéré à la Santé. Il en sortait en janvier 1917 pour l’instruction de son procès à la 2e Division à laquelle appartenait son régiment.
Sans surprise, il était condamné à mort le 24 mai. Le Conseil de révision ne trouvait le 2 juin aucun vice de forme. Le Commissaire Rapporteur se crut autorisé, dès le lendemain, à n’envoyer au Ministère qu’un compte rendu télégraphique et non le dossier, procédé permis par la circulaire du 20 avril 1917 en cas d’urgence :
« Dans les cas exceptionnels où les nécessités de l'action militaire paraîtraient exiger impérieusement une prompte répression, les propositions pourront m'être adressées télégraphiquement, en même temps qu'un exposé succinct, mais très précis, des circonstances dans lesquelles a été commis le crime qui a motivé la condamnation »
Il se fit rappeler à l’ordre le 4 juin. L'affaire Louis n’entrait pas dans le cadre « des cas exceptionnels »
Après avoir pris, sans pression de temps, la décision de rejet de grâce, cette dernière était signifiée le 27 juin et le 28, Louis tombait à 18 h 30 sous les balles.
Il n’y a pas eu d’état d’âme, tant à la Justice militaire que civile pour « laisser la justice suivre son cours » :
On voit que si n’apparaît plus, depuis la circulaire du 20 avril 1917, le poids des juges, (encore que : voir Fernez) délestés de leur latitude de demander ou non la grâce, le commandement, par le biais de l’opinion des autorités hiérarchiques, reste un facteur d’importance dans le destin du condamné à mort, car, outre les faits, leurs avis sont pris en forte considération non seulement par la justice militaire, mais aussi, plus étonnamment par la justice civile.
On note que le critère de « pitié » entre dans ceux pris en compte à Paris.
Prisme souligne à cette occasion combien il faut faire attention quand on décompte les fusillés de juin assimilés hâtivement à des mutins. Louis, fusillé de fin juin 1917 l’a été pour une faute de décembre 1915.
La 1ère partie de 1917 s'achève, ... suite à venir.
Cette défense désinvolte a été mal appréciée par son commandant de compagnie :
Quant au chef de corps, ces deux prévenus sont tout ce qu’il abhorre et il donne le même conseil pour les deux.
Avis sur Daubignard :
Malgré cette animosité du colonel, les juges ont demandé la grâce. Il y a un doute sur cette demande spontanée des juges pour Daubignard car il y a trace d’une intervention présidentielle pour l’imposer :
Le 18, le Conseil de révision n’avait pas encore statué. Il l’a fait le 19 en confirmant la condamnation. Il a dû recevoir aussi en urgence le télégramme présidentiel, si l’on en croit la précaution qu’il a prise :
On ne sait qui a alerté le Président.
L’examen du dossier au Ministère de la Guerre a amené finalement ses fonctionnaires à confirmer la sentence, proposition entérinée par la Commission des grâces, sensible à la position du Commandement :
En foi de quoi le 2 mai, la Présidence donnait son feu vert pour Daubignard, ainsi d’ailleurs que, ce même jour, pour Defis et 48 heures après la double sentence était exécutée.
Une "sortie" lourde de conséquences:
La majorité de la cohorte du mois a évité la mort comme Poilpré et Guernstein.
Le 30 novembre 1916, vers 18h00, les soldats Poilpré et Guernstein de la 2e compagnie du 176e RI s’étaient constitués prisonniers au dépôt intermédiaire du régiment à Zeitenlick. Ils avaient quitté, sans autorisation, le régiment depuis le 21 novembre. Ces militaires ont été internés à Salonique au camp de Zeitenlick, la 2e compagnie du régiment occupant une position aux environs de Slivnica au Nord-Ouest de Krani en Serbie.
La 2ème compagnie occupait la première ligne. A l’appel de 6h00 du matin du 22 novembre, Poilpré et Guernstein étaient manquants. Les 2 soldats avaient emporté leurs armes, équipements et vivres.
Le soldat Guernstein fournissait des explications lors de l’interrogatoire des accusés.
Le soldat Poilpré fournissait également des explications.
Poilpré expliqua qu’il voulait faire la « bombe » avec son argent. Pour lui, il n’avait pas abandonné son poste, la compagnie était bien en 1ère ligne mais il n’était pas en sentinelle.
Les témoins étaient interrogés à leur tour.
Le soldat Lavache témoigna sur Poilpré :
Les soldats Robin, Adler et Engelibert, témoins, avaient tenu le même genre de propos : les soldats avaient été prévenus de l’attaque le matin même ; dès la distribution de pain faite, Poilpré et Guernstein sont partis en direction du village de Krani. Guernstein aurait déclaré au soldat Engelibert : si je savais le bulgare, je ferais comme lui (référence à un soldat bulgare qui avait déserté et s’était présenté devant les lignes françaises une cigarette à la bouche).
Dans leurs déclarations, Poilpré et Guernstein exprimèrent les plus vifs regrets pour leurs fautes.
Le commissaire-rapporteur demanda la traduction de ces 2 militaires devant le Conseil de Guerre de la 156e division pour abandon de poste en présence de l’ennemi en application de l’article 213 du code de justice militaire.
Dans les notes d’audience, le greffier a noté la bonne attitude des 2 accusés mais également leurs protestations lors de la lecture des dépositions des témoins.
Le 28 janvier 1917, le Conseil de Guerre de la 156e DI a condamné à la peine de mort les soldats Poilpré et Guernstein, lesquels s’étaient pourvu en révision. Le 1er février, un recours en grâce a été signé par les membres du Conseil de Guerre en faveur des condamnés à mort.
Le 15 février, le Conseil de révision de l’Armée d’Orient s’était réuni pour statuer sur le pourvoi de ces soldats. Le Conseil déclara que : conformément à l’article 22 du code de justice militaire, nul ne peut faire partie d’un Conseil de Guerre à un titre quelconque s’il n’est pas français ou naturalisé français et âgé de 25 ans. Comme un des juges n’avait pas les 25 ans requis et sur l’absence de débat oral lors de la séance, le Conseil de révision a cassé et annulé le jugement prononcé par le Conseil de Guerre de la 156e DI.
Le 6 mars, le Conseil de Guerre de la 16e DIC s’était réuni pour rejuger Poilpré et Guernstein pour abandon de poste en présence de l’ennemi. Les mêmes témoins étaient convoqués, seul manquait le caporal Adler soigné pour maladie à l’hôpital temporaire n°8. Dans les 5 pages des notes d’audience, Guernstein a reconnu avoir quitté la compagnie, avoir rejoint Poilpré sur la route de Krani, être monté dans le train en gare de Florina. Nous voulions aller nous amuser avec l’argent que nous possédions l’un et l’autre indiqua Guernstein qui déclara ignorer la gravité de sa faute et la regrettait. Poilpré souligna : il est exact que j’ai abandonné ma compagnie, Guernstein m’a rejoint sur la route de Krani vers 5h30, nous avons pris le train à Florina et nous sommes allés à Salonique. Poilpré expliqua que le soldat Lavache n’avait pas bien compris ses propos. Là aussi, le greffier a noté la bonne attitude des 2 accusés.
A l’issue des débats, le Conseil de Guerre de la 16e DIC a condamné les soldats Poilpré et Guernstein à la peine de mort. A l’issue de ce second jugement, Poilpré et Guernstein ne s’étaient pas pourvus en révision.
Sur avis favorable du général commandant en chef les Armées alliés en Orient transmis au Ministère de la Guerre, le 14 mai 1917, le Président de la République a commué les peines de mort prononcées en 20 ans de prison.
Le soldat Guernstein a été incarcéré à la maison centrale de Nîmes. Le 15 septembre 1919, le Président de la République lui a accordé la remise de la moitié de sa peine. Guernstein a été élargi le 15 décembre 1921, dirigé vers le 96e RI ; il a été renvoyé dans son foyer le 26 janvier 1922.
Incarcéré à la maison centrale de Nîmes, le 22 décembre 1920, Poilpré a reçu une remise de 5 ans de sa peine. Le 14 janvier 1922, par décision n°7474 du Ministre de la Guerre du 17 décembre 1921, l’exécution de sa peine a été suspendue.
Cette « sortie » à Salonique pour « faire la bombe» a failli leur coûter cher, du fait de leur départ la veille d’une attaque et de leur réputation de « tire-au-flanc». Pour le reste, on a bien quitté « l’énergique célérité » du début de la guerre. Disparus le 22 novembre 1916, leur cas va occuper la Justice militaire durant 7 mois. Ils ne sont jugés que le 28 janvier, jugement annulé le 15 février, recondamnés le 6 mars avant commutation de la peine de mort en 20 ans le 14 mai.
4- Cohorte d’Avril : 9 condamnés à mort, 1 exécuté, 7 commutations de peine, un jugement annulé pour vice de forme par les conseils de révision d’armée, sur les 7 examinés.
Neuf condamnés à mort, un pourvoi en révision accepté sur 7 demandés, 7 grâces demandées, toutes acceptées. C’est ce mois qui détient le nombre de condamnés à mort le plus faible de 1917. On dénombre un fusillé, Petitjean, le seul dont le dossier n’a pas été transmis.
Il s’agit du dernier mois avant la mise en œuvre de la transmission obligatoire des dossiers. On s’aperçoit que dans la pratique, on est quasiment arrivé à ce résultat en amont de la publication de la circulaire ministérielle du 20 avril 1917. Elle ne révolutionnera donc pas la pratique. La grâce, chose rare, a été systématique ce mois-là pour les condamnations aux armées. Les quatre demandes de grâce pour militaires à l’arrière ont toutes été rejetées : un assassin, trois traîtres. Les procédures sont au point. Ainsi le dossier de Georges Ausilia, condamné le 19 avril pour un abandon de poste, pourvoi rejeté le 30, est dirigé, via le GQG, vers la cellule parisienne de la Justice Militaire. Celle-ci informe la Direction des Grâces de ses propositions le 28 mai. Le Garde des Sceaux signe son accord le 31 mai. Le décret présidentiel sort le 4 juin avec une commutation en 20 ans de prison. Si la cellule « Guerre », semble prendre un certain temps dont il faut défalquer celui mis par les diverses autorités hiérarchiques pour inscrire leur avis, le passage à la Direction des Grâces est rapide, ainsi que l’entérinement à la Chancellerie élyséenne.
Qu’est ce qui a valu à Petitjean d’être le seul fusillé de la cohorte d’avril ?
Les voies de fait envers un supérieur pendant le service ont été assez fréquentes au cours de ce conflit. Le dossier du soldat Petitjean illustre ce type de « crime » sanctionné par l’article 223 du code de justice militaire. La liste ci-dessous présente les condamnations antérieures du soldat Petitjean.
Pour les 2 dernières condamnations, Petitjean avait bénéficié d’une remise de peine et d’une suspension de peine.
En 1917, sa remise de peine d’un an de travaux publics sur les 5 écopés au Conseil de Guerre de Tunis en mars 1914 le maintenait sous cette juridiction encore pendant un an.
En 1917, il n’avait encore jamais vu le feu. Les Ateliers de Travaux Publics fonctionnant jusqu’en 1916 exclusivement en Afrique du Nord, il avait passé tout ce temps (1914-1916) en Algérie. Son arrivée en métropole était due à la décision ministérielle de l’automne 1916 de déplacer certains de ces Ateliers sur le front, avec leurs détenus, armés de pioches et pelles, pour effectuer les travaux salissants et dangereux. Cela répondait à l’idée qu’on ne pouvait laisser, sur le plan du moral, les indisciplinés à l’arrière et les bons soldats au danger.
Une note du fin janvier 1917 avait le point sur ce processus en cours :
Petitjean a suivi le déplacement de son atelier, le numéro 2. Non endivisionnée, cette unité était rattachée pour la discipline au QG de l’Armée sur le territoire de laquelle elle était implantée.
C’est pour cela que le 14 avril, à Bar-le-Duc, Petitjean comparaissait devant le Conseil de Guerre du Quartier général de la 2e Armée. Pour quelles raisons ?
Selon le rapport du commissaire-rapporteur Cuaz, à Brocourt, le 11 mars, les sergents Chiraussel et Desumeur conduisaient le soldat Delhommeau dans une cellule où étaient incarcérés des détenus dont Petitjean. Ce dernier injuria les sous-officiers en les traitant de « vaches, buveurs de sang », ajoutant qu’il tuera le premier qui rentrerait. Posté près de la grille d’entrée de la cellule, Petitjean lança des pierres, Desumeur parvint à faire rentrer Delhommeau « ami plus qu’intime » de Petitjean et rendit compte au commandant de l’atelier.
Vers 17h00, le sergent Chiraussel, sergent de semaine accompagné du lieutenant Suchaud, des sergents Baignon, Désumeur, Rousse, Boule, de 4 gardes, donnait l’ordre aux 18 détenus de sortir de cellule pour l’appel du soir. Tous sortirent du local sauf Petitjean. Celui-ci jeta des pierres dont une toucha Chiraussel à la tête. Chancelant et aveuglé par le sang, le sergent tira 4 coups de revolver sur Petitjean sans le toucher, Chiraussel fut porté dans sa chambre pour être pansé puis fut conduit à l’hôpital de Bar-le-Duc sur ordre du médecin, le sergent ayant une plaie de 4 cm au niveau de l’arcade sourcilière droite. Le sergent Baignon, qui prit la suite de Chiraussel, fut également accueilli avec des jets de pierres. Petitjean s’approcha alors de Baignon pour tenter de mieux le frapper mais celui-ci lui tira une balle dans la cuisse qui le blessa « très légèrement ». Petitjean maîtrisé, les militaires purent vérifier l’état de la cellule pour éviter les évasions.
Petitjean était en prison depuis la veille sur la requête du rapporteur du Conseil de Guerre qui menait une enquête sur une affaire de « pédérastie » où il était impliqué. Le lieutenant Suchaud soupçonne Delhommeau se s’être fait volontairement incarcéré pour rejoindre Petitjean.
Le rapport du commissaire-rapporteur était très défavorable ; il indiquait que Petitjean était un individu excessivement dangereux, d’une moralité déplorable. Il déposa une plainte en demandant sa comparution devant un Conseil de Guerre pour voies de fait et outrages envers des supérieurs pendant le service. Son défenseur était le soldat Deville, avocat dans le civil.
Les protagonistes ont été entendus par le commissaire-rapporteur sauf le lieutenant qui était soigné à l’hôpital pour maladie comme l’indique le certificat du médecin-chef.
Les déclarations des détenus Jézequel et Blineau ne sont pas très précises.
Le sergent Baignon fournit sa version des faits :
Durant son interrogatoire, Chiraussel précisait qu’il avait été soigné à l’hôpital de Bar-le-Duc :
Les déclarations du sergent Désumeur sont similaires à celles des sergents Baignon, Chiraussel et Rousse.
Interrogé par le lieutenant Suchaud, en tant qu’officier de police judiciaire, Petitjean refusa de répondre aux questions. Par contre, durant son interrogatoire par le commissaire-rapporteur, Petitjean fournit sa version des événements. Vers 16h00, il aurait manifesté sa désapprobation envers les procédés des sous-officiers qui auraient maltraité Delhommeau. Le sergent Désumeur lui aurait dit : ça va être ton tour, tout à l’heure. Ce dernier aurait donné son révolver au sergent Chiraussel pour le tenir en joue pendant que Désumeur ouvrait la porte de la cellule. Petitjean affirma qu’il pensait qu’il allait être mis aux ficelles et passé à tabac, il refusa donc de sortir, Désumeur lui aurait jeté des pierres et Chiraussel lui aurait tiré une balle entre les jambes sans le toucher. Petitjean continua son récit en précisant que ¾ heure plus tard, le lieutenant commandant de l’atelier et les sous-officiers seraient revenus en ordonnant aux prisonniers de sortir ce qu’ils firent tous sauf lui. Le lieutenant aurait donné l’ordre aux sous-officiers de sortir leurs révolvers et d’aller le chercher. Chiraussel aurait tiré 5 balles dont une qui le blessa à la cuisse. Petitjean aurait alors jeté des pierres et Chiraussel serait parti pour un motif qu’il ignore. Les sergents Désumeur et Alfonsi auraient tiré 12 balles, le lieutenant aurait également tiré une balle mais aucune ne l’aurait touché. Le lieutenant aurait ordonné d’aller chercher des couvercles de marmite pour se protéger, de la paille pour l’enfumer et aurait ordonné à 2 détenus de le faire sortir en indiquant « je lui donne 2 minutes pour réfléchir, je veux te sortir d’un mauvais pas ». Selon sa déposition, Petitjean aurait obtempéré, se serait couché, on l’aurait attaché 48 heures au pied d’un arbre.
Le médecin aide-major de 1ère classe qui a examiné la blessure de Petitjean, a déclaré que la plaie concernait seulement la peau et la couche sous-jacente. En ce qui concerne la blessure de Chiraussel, le médecin indiqua la peau, les muscles et peut-être l’os frontal étaient atteints.
Les notes d’audience reflètent ces divergences entre les dépositions des témoins et des accusés.
Après la lecture des pièces du dossier et des questions posées aux témoins et à l’inculpé, les juges, en répondant oui aux 8 questions posées, ont condamné à l’unanimité le soldat Petitjean à la peine de mort en application des articles 223, 224, 135, 139, 187 du code de justice militaire et de l’article 9 de la loi du 22 juillet 1867. Les juges n’ont pas accordé les circonstances atténuantes dans ce dossier.
Petitjean s’était alors pourvu devant le Conseil de révision mais attendu que le Conseil de Guerre était compétent et constitué conformément à la loi, que la procédure est régulière et que la peine a été bien appliquée aux faits légalement qualifiés et déclarés constants, le pourvoi a été rejeté le 18 avril. Dans ce dossier, il est bien mentionné qu’aucune demande de grâce n’a été adressée par les juges à la Présidence de la République. Cette pièce du dossier, datée du 20 avril précise : attendu qu’après examen de la procédure, nous estimons qu’il n’y a pas lieu de provoquer, en faveur du condamné, une mesure exceptionnelle.
Ironie de l’histoire, c’est ce 20 avril qu’était publiée la lettre ministérielle mettant fin à la notion de l’exceptionnalité du recours en grâce auprès du Président de la République, ce dernier redevenant le seul décisionnaire en la matière.
Le 20 avril, à Rampont, le médecin-chef Brunel commis à cet effet a constaté le décès de Petitjean.
Dans ce dossier, les déclarations des protagonistes sont contradictoires. Le sergent Baignon déclara avoir blessé Petitjean alors que ce dernier affirma que c’est Chiraussel qui aurait tiré. Petitjean a reconnu avoir lancé des pierres mais il affirma ne pas savoir si c’est lui qui a blessé Chiraussel. On se demande pourquoi Chiraussel aurait lancé des pierres à Petitjean pour le faire sortir de la cellule alors qu’il était accompagné de 4 autres sergents et de 4 gardes, et que 2 détenus avaient l’ordre de faire sortir Petitjean. On se demande également comment Petitjean n’aurait pas été, ou si peu, blessé avec le nombre de balles tirées selon lui lors de son extraction, nombre de tirs qui n’est pas corroboré dans les pièces du dossier alors que les 5 premiers tirs sont bien mentionnés.
Le Général en Chef incline vers la clémence:
Le 20 mars 1917, la 11e compagnie du 173e RI tenait les tranchées de la 1ère ligne à la lisière du bois des Caurières au Nord-Est de Douaumont. Depuis mai 1916, le 173e était dans le secteur de Verdun changeant de zone : la cote 304, la côte du Poivre, la cote 344, il y restera jusqu’en octobre 1917. La 3e section était appelée à son tour à tenir la première ligne. L’installation terminée, le sergent Bouvard signala alors au capitaine Santini commandant de la compagnie, que le soldat Chazette n’avait pas suivi son escouade en profitant de l’obscurité pour probablement retourner à l’abri où la section avait passé la journée précédente. Le capitaine envoya un agent de liaison, le soldat Guinard, pour donner l’ordre à Chazette de rejoindre sa section. Chazette déclara à Guinard qu’il allait la rejoindre. Deux heures plus tard, Chazette n’avait toujours pas rejoint sa section. Guinard retourna une 2ème fois puis une 3e fois. Le trajet entre la 1ère ligne et l’abri étant dangereux, lorsque Guinard revint chercher Chazette la 3ème fois fois, Guinard le prévint : je ne voudrais pas me faire casser la gueule pour toi, si je suis obligé de revenir te chercher encore une fois, je te rentre dedans. Impressionné Chazette s’équipa, quitta l’abri, fit semblant de rejoindre sa section et disparut. Il resta introuvable pendant tout le séjour de la compagnie en 1ère ligne. Il ne la rejoignit que le 23 mars, lorsqu’elle quitta la 1ère ligne pour aller au repos à 2 km des lignes ennemies.
Le capitaine Santini demanda la comparution de Chazette devant le Conseil de Guerre de la 126e Division pour abandon de poste en présence de l’ennemi. Les témoins cités à comparaître sont le sergent Claver et le soldat Guinard, le sergent Bouvard ne pourra pas témoigner, il avait été tué au champ d’honneur.
Le capitaine Massoni est chargé d’instruire la plainte contre Chazette. Celui-ci n’a été condamné qu’une fois pour vol en 1910. Le 9 avril, il a été écroué à la prison militaire de la division. Chazette était noté comme « mou et sans courage ».
Interrogé, Chazette avait tenté de se justifier :
Le sergent Claver témoigna :
A son tour, le soldat Guinard donna son témoignage :
Le 11 avril, le Conseil de Guerre de la 126e DI s’était réuni à Verdun à la caserne Bevaux. Aux 3 questions posées aux juges, ceux-ci ont répondu : oui sans admettre les circonstances atténuantes et ont condamné Chazette à la majorité de 4 voix contre une, à la peine de mort en application des articles 213, 187, 139 du code de justice militaire.
Chazette s’était pourvu en révision mais le Conseil de révision, dans sa séance du 18 avril, a rejeté le recours formé par le condamné.
A l’unanimité, les juges ont signé le recours en grâce. Dans le dossier 2840 S17 des archives du Ministère de la Justice, on trouve cette remarque au sujet de Chazette : les généraux de Corps d’Armée et d’Armée estiment que malgré son jeune âge, Chazette ne mérite aucune pitié. Les autres autorités hiérarchiques, général en Chef compris inclinent vers la clémence. La « guerre » conclut à la commutation en 15 ans. Le rédacteur du Ministère de la Justice poursuit : proposition d’adhérer. La conclusion de la « justice »est : vu et approuvé.
Le 22 mai, le Président de la République a commué la peine de mort requise contre Chazette.
Détenu à la maison centrale de Nîmes pour y purger sa peine, Chazette a obtenu le 10 novembre 1920 une remise de 4 ans de prison sur les 15 ans. Le 12 janvier 1921, Chazette a obtenu une 2ème remise de 5 ans de prison. Le 28 septembre 1921, Chazette a obtenu une dernière remise de 5 ans de prison. Le 26 octobre 1921, Chazette était libéré.
Pour quelle raison les juges ont-ils signé le recours en grâce de Chazette ? Difficile à dire par rapport à d’autres cas similaires : Krief, Kilani, Mayet en février, auxquels elle a été refusée et qui ont été exécutés. Quand la demande a été faite en février pour Varain, la commutation a été accordée. Ce type de faute a-t-il été considéré à Paris comme non justiciable d’exécution capitale ? Prisme va essayer de voir sur les mois suivants si cette tendance se concrétise.
Il est bon de s’arrêter sur les bilans de ce quadrimestre, dernier à fonctionner avec la procédure de la demande de grâce ou de commutation des peines, à la disposition des juges et du Commandement. On peut noter une tendance générale. Ainsi janvier semble se rapprocher des errements des années antérieures avec un nombre conséquent de condamnés à mort : 46, 8 rejets de grâce et 12 fusillés dont 4 sans sollicitation de grâce. En février, la conjonction de la révision et des grâces a abouti à ce que de 14 condamnés à mort, on est arrivé à 3 exécutés. En mars, avec un nombre de condamnés plus important, 23, on n’arrive qu’à 5 exécutés. Deux ont vu leur jugement annulé, 20 sur 21 ont été bénéficiaires d’une demande de grâce, dont 2 rejetées en métropole et 2 au Maroc sur décision du Résident Général. En avril, la tendance a été la même, à savoir la demande de grâce quasi systématique.
Sur les 21 exécutés du quadrimestre dont 4 en Afrique du Nord, près de 57% l’ont été en janvier. Dans les trois mois qui suivent n’ont eu lieu que 9 exécutions, dont 4 pour tentative d’homicide par arme à feu et une pour voie de fait sanglante.
Il est temps de voir maintenant quels ont été les changements, s’il y en a eu, provoqués par l’application de la lettre ministérielle du 20 avril 1917 qui enlevait définitivement au commandement la prérogative obtenue en début de guerre de faire ordonner des exécutions de condamnés à mort sans avoir à en demander la permission au politique. L’événement, inattendu de la strate politico-militaire, qu’a été l’explosion des mutineries va mettre à rude épreuve le processus en cours d’une justice, en voie d’humanisation et de garanties pour les accusés, et subitement confrontée au spectre d’une désobéissance collective, suspectée par certains d’être révolutionnaire et susceptible de menacer les institutions.
Prisme va continuer à analyser, pragmatiquement et successivement les 8 mois restants de l’année en gardant en tête les deux faits structurants de cet espace de temps : la prise de contrôle du politique sur le droit de vie et de mort des citoyens-soldats et la menace des mutineries.
5- Cohorte de Mai : 34 condamnés à mort, 5 exécutés, 23 commutations de peine, 6 jugements annulés pour vice de forme par les conseils de révision d’armée, sur les 33 examinés.
Au niveau des proportions, le mois de mai se singularise peu ou pas par rapport aux mois précédents, sauf que tous les dossiers ont été transmis. Sur les 5 fusillés, deux l’ont été en Afrique du Nord.
Frencia, du Bataillon Territorial de la Chaouia, a tenté de tuer son adjudant pour s’emparer de ses économies le 12 mars 1916 à El Boroudj au Maroc. Condamné à mort le 18 mai, il a attendu le 31 juillet pour apprendre la décision présidentielle négative suite à la transmission de son dossier le 25 juin. Il était fusillé à Casablanca le 2 Août à 6h00.
Sylvain Lacherade, engagé volontaire pour 4 ans en 1909 était titulaire de 5 désertions avant 1914, ce qui l’avait amené à être affecté en 1915 au 4e BILA. A sa nouvelle désertion, il avait été envoyé, en octobre 1916, dans une unité du 5e Bila faisant partie, dans le Sud Tunisien, de la garnison d’un fort régulièrement harcelé par des irréguliers : Dehibat. Il s’en échappait le 12 décembre 1916 en compagnie de Lucien Fabre. Moins chanceux que ce dernier, il avait été rattrapé. Jugé le 23 mai pour « abandon de poste en présence de rebelles armés », jugement confirmé par le Conseil de révision le 1er juin, il était exécuté le 3 Août à 6h00 à Médenine, le Président de la République ayant « laissé la justice suivre son cours ».
Sur le front Nord-Est, la cohorte de mai n’a fourni que 3 fusillés.
Pour Désiré Heuls, la conviction du commissaire rapporteur dans ses conclusions du 12 mai 1917 est nette :
En ressort l’image d’un homme qui serait calculateur et dont les antécédents judiciaires le font soupçonner d’être incorrigible. Heuls s’est bien constitué prisonnier à peine arrivé à Paris :
A-t-il pensé, comme on le lui prête, éviter de participer à une attaque sans risque pénal pour lui ?
A l’audience, le 18 mai, il donnera une motivation sans ambiguïté :
En foi de quoi, il a été condamné à mort avec refus des circonstances atténuantes à 4 contre 1, jugement confirmé en Conseil de révision le 2 juin et grâce rejetée le 27 juin avec exécution 48 heures après le 29.
Ses condamnations antérieures : « professionnel de la désertion », lui ont été fatales :
Au même régiment, le 43e RI, le 16 avril, un jour avant Heuls, un autre soldat commettait le même type d’abandon de poste mais lui n’était pas fusillé.
L'importance de l'avis des juges:
La 9e compagnie devant s’élancer à 6h40, ordre fut donné aux hommes de s’équiper et de se préparer à l’attaque. C’était le 16 avril, le 3e bataillon du 43e RI occupait la 2e ligne d’où devait partir directement l’assaut du plateau de Vauclerc. La 2e section dont fait partie le soldat Fernez, était abritée, en attendant l’heure de départ, dans une sape à l’extrémité sud du boyau 10 près de Craonnelle.
Vers 5h15, le commandant de la compagnie était prévenu que Fernez venait de s’esquiver sous prétexte d’aller chercher de l’eau. On le fit rechercher mais en vain. Fernez ne put être retrouvé, ne reparut plus à la compagnie avant le 24 avril à Baslieux-lès-Fismes. Suite à ces évènements, le chef d’escadron Marthe déposa donc une plainte contre Fernez.
Fernez avait été l’objet d’une plainte en Conseil de Guerre en octobre 1916 au 127e RI pour des faits similaires. Le commissaire-rapporteur souligne que sa conduite fut analogue dans la Somme en septembre 1916 où il ne dut qu’aux circonstances et à l’indulgence du colonel commandant le régiment, de n’encourir qu’une peine disciplinaire. Fernez avait été envoyé en section de discipline où il resta jusqu’en janvier 1917.
Fernez a été écroué à la prison du QG de la 162e DI le 8 mai.
Le 20 mai, le commissaire-rapporteur décida de déférer Fernez devant le Conseil de guerre pour avoir commis dans les environs de Craonnelle (Aisne) un abandon de poste en présence de l’ennemi.
Témoignage du caporal Cornette :
Témoignage du capitaine Caulliez :
Témoignage du caporal Picavet :
Fernez s’expliqua :
Comme son camarade Heuls, il donne comme motivation de son abandon de poste, la peur.
Le 29 mai, le Conseil de Guerre de la 162e DI, dix jours après la condamnation de Heuls, s’était réuni pour juger le soldat Fernez. A la majorité de 3 juges contre deux, Fernez a été condamné à la peine de mort en application du fameux article 213 & 1 du code de justice militaire. Le même jour, Fernez s’était pourvu en révision. Le 8 juin, le Conseil de révision de la 4e Armée a rejeté son pourvoi.
A l’unanimité, les juges ont signé le recours en grâce, une pratique donc parfois encore usitée un mois après la parution de la circulaire du 20 avril 1917. Il est vrai que ce processus n’a pas été formellement abrogé dans la circulaire et que rien n’empêchait de le faire coexister avec les nouvelles directives. Ce recours peut même s’avérer comme un argument décisionnel pour la direction des affaires criminelles et des grâces.
Le 8 juillet, sur le rapport du Ministre de la Guerre et après l’avis du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Président de la République a commué la peine de mort requise contre Fernez en 20 ans d’emprisonnement. La « justice » a considéré que sa constitution malingre et le recours signé par tous les juges inclinait vers une mesure de clémence, la condamnation n’ayant été obtenue que par 3 juges contre deux. Fernez a été écroué à la maison centrale de Fontevrault où il décéda le 15 octobre 1918.
On a pu observer combien les cas Heuls et Fernez étaient semblables, même pour les condamnations antérieures. La différence tient ici à l’aspect malingre du condamné mais surtout à la décision prise à 3 contre deux et à l’initiative des juges de signaler leur souhait de commutation. Reste que sur le plan des faits, semblables, nous avons, initialement, deux comportements et jugements de Conseils de Guerre différents.
Le Président de la République laisse la justice suivre son cours:
René Samuel Levy, lui, n'a pu s’extirper des conséquences d’une première condamnation le 6 octobre 1914. Soldat au 151e RI, il avait pris 20 ans de prison ce jour-là pour abandon de poste et vol dans une maison abandonnée fin août-début septembre. Sa peine, purgée à la Centrale de Clairvaux, était suspendue au bout de 18 mois avec obligation d’engagement aux Bat d’AF. Il avait retrouvé le front le 10 mars 1916 au 3e BMILA. Le 26 janvier, il partait en permission pour 7 jours à Paris et décidait de ne pas rentrer. Aux gendarmes, qui l’arrêtaient le 24 mars, il déclarait qu’il était parti car, à son unité, « il était trop malheureux ». En attente de jugement, il avait été mis à la Section de discipline de la Division. Les sections de discipline étaient alors en train de se mettre en place. L’idée en remontait à janvier 1915.
L’enthousiasme n’avait pas été général, car cela supposait pour les corps de nouvelles contraintes :
L’intérêt résidait dans le fait que la décision d’envoi dans ces unités était dans la main du commandement. Un conseil de discipline, composé de trois officiers du régiment, en décidait souverainement. Le Ministère de la Guerre en octobre 1915 s’était contenté de normaliser la pratique au front.
Enfin, par circulaire n° 9.412 du 13 août 1916, le GQG avait autorisé, sous réserve de lui en rendre compte, la création facultative de Sections de Discipline (S.D.) dans les Divisions.
Les critères d’envoi étaient assez flous.
Voici comment la 97e Division d'Infanterie Territoriale l’avait présentée, à sa création en novembre 1916 : « Une section de discipline est créée à la 97e DIT. Y seront envoyés, très prochainement, les quelques rares individus, tarés, condamnés, ivrognes, qui, la plupart venus de corps étrangers, font tache au régiment qui ne se compose que d’honnêtes gens »
René Lévy en avait donc (comme Rostagni jugé en janvier 1917) bénéficié. Le 11 septembre 1917, le général Pétain prendra soin de préciser les critères d’envoi « suite aux dérives constatées » :
« Ces formations sont destinées à réunir, dans des groupements spéciaux, les hommes dont l'inconduite habituelle est d’un exemple pernicieux pour leurs camarades des Corps de troupe, mais qui cependant sont susceptibles de s’amender » [..]
Les erreurs d’affectation les plus fréquemment relevées sont les suivantes :[..]
« Affectation d'office aux Sections de Discipline de tous les hommes qui ont été traduits devant un Conseil de Guerre. Cette affectation d’office doit être écartée. Quelle que soit la situation d’un homme à la suite de sa comparution devant un Conseil de Guerre, acquittement, sursis, suspension de peine, cet homme doit être versé dans un Corps de troupe »
Levy, en attente de Conseil de Guerre, n’avait donc pas fatalement sa place en S.D. Ces S.D. étaient soumises à un travail incessant et éreintant censé leur amener l’idée de raccourcir au plus vite leur séjour « en s’amendant ».
Ainsi, la nuit du 5 avril 1917, Lévy et ses congénères, transportaient, du dépôt au front, de lourdes torpilles de Crapouillots, dits d’Artillerie de tranchée, en vue de l’offensive du 16 avril, sous des tirs de barrage adverses. En plein milieu de cette corvée, après altercation avec son chef sur sa fatigue, Lévy avait disparu. Il était arrêté à Bordeaux le 24 avril. Il ne s’agissait plus, comme la première fois d’une désertion simple mais d’un abandon de poste en présence de l’ennemi. Il était condamné à mort le 18 mai, jugement confirmé en révision le 25, avec dans la foulée transmission de son dossier à Paris. A cette occasion, la cellule chargée de l’examen ne travaillait pas que sur dossier et pouvait poursuivre l’enquête sur ce qui lui paraissait obscur.
Les précisions fournies n’empêchèrent pas la Présidence de la République d’autoriser le 9 juillet l’exécution qui eût lieu le 13 du même mois.
Quels ont été les critères de choix à Paris ?
Le rédacteur de la Direction des Grâces a été assez enclin, sur le plan formel, de relever une des raisons soulevées par la « Guerre » : la perte d’exemplarité de l’exécution trois mois après la sentence, raison qui ne porte pas sur la nature de la faute, mais sur l’effet qu’on recherche, pour proposer de surseoir. Son supérieur hiérarchique a fermé cette ouverture.
Un "sacré" personnage:
Avec Edouard LOUIS, on s’approche d’un personnage de roman. Engagé volontaire en 1909 dans la cavalerie, il avait commencé par déserter en 1911 et fait connaissance avec le Conseil de Guerre qui lui infligea un an avec sursis. Quatre mois plus tard, il comparaissait à nouveau le 11 décembre 1911 pour complicité de vol et écopait d’un an de prison. Libéré après 6 mois, par réduction de peine, il allait finir son temps d’engagement au 5e Bila, en tant qu’auteur d’un délit de droit commun. A la mobilisation, il rejoignait, en tant qu’ancien Bat d’Af le 4e Groupe Spécial à Mamers. Il le quittait pour le 115e RI puis le 8e RI. A peine arrivé à ce nouveau régiment, au cours d’une attaque le 7 juin 1915, il se distinguait, était nommé sergent sur le champ de bataille et décoré dans les jours suivants de la Croix de Guerre. Bien vu, il obtenait directement de son colonel le 16 septembre un sauf-conduit de quelques jours pour négocier un mariage par procuration. Le régiment perdait sa trace avant de le récupérer en octobre. Ayant rejoint son dépôt du 4e Groupe Spécial à Mamers, il y avait été arrêté et mis en prévention du Conseil de Guerre permanent de la 4e Région pour désertion à l’intérieur et avait réussi à obtenir un non-lieu le 30 novembre. Il rejoignait son régiment le 8 décembre et était cassé de son grade sur le champ.
Le commissaire rapporteur expose :
Commence alors une longue cavale résumée sur le plan moral par le Commissaire rapporteur :
Arrêté, ramené, un ordre d’informer était signé à son encontre le 10 octobre. Hospitalisé le 13 pour soupçon de gale, il s’échappait le 30 octobre 1916 près d’un an après son abandon de poste de décembre 1915.
On imagine la rage du commissaire rapporteur devant cet homme « portant beau » et prodigieux bonimenteur, qui, en désertion n’avait cessé de commettre des méfaits.
La lettre du Commissaire de police de Saint Nazaire du 10 juillet 1916 en fait foi :
Il était à nouveau arrêté à Paris le 22 novembre et incarcéré à la Santé. Il en sortait en janvier 1917 pour l’instruction de son procès à la 2e Division à laquelle appartenait son régiment.
Sans surprise, il était condamné à mort le 24 mai. Le Conseil de révision ne trouvait le 2 juin aucun vice de forme. Le Commissaire Rapporteur se crut autorisé, dès le lendemain, à n’envoyer au Ministère qu’un compte rendu télégraphique et non le dossier, procédé permis par la circulaire du 20 avril 1917 en cas d’urgence :
« Dans les cas exceptionnels où les nécessités de l'action militaire paraîtraient exiger impérieusement une prompte répression, les propositions pourront m'être adressées télégraphiquement, en même temps qu'un exposé succinct, mais très précis, des circonstances dans lesquelles a été commis le crime qui a motivé la condamnation »
Il se fit rappeler à l’ordre le 4 juin. L'affaire Louis n’entrait pas dans le cadre « des cas exceptionnels »
Après avoir pris, sans pression de temps, la décision de rejet de grâce, cette dernière était signifiée le 27 juin et le 28, Louis tombait à 18 h 30 sous les balles.
Il n’y a pas eu d’état d’âme, tant à la Justice militaire que civile pour « laisser la justice suivre son cours » :
On voit que si n’apparaît plus, depuis la circulaire du 20 avril 1917, le poids des juges, (encore que : voir Fernez) délestés de leur latitude de demander ou non la grâce, le commandement, par le biais de l’opinion des autorités hiérarchiques, reste un facteur d’importance dans le destin du condamné à mort, car, outre les faits, leurs avis sont pris en forte considération non seulement par la justice militaire, mais aussi, plus étonnamment par la justice civile.
On note que le critère de « pitié » entre dans ceux pris en compte à Paris.
Prisme souligne à cette occasion combien il faut faire attention quand on décompte les fusillés de juin assimilés hâtivement à des mutins. Louis, fusillé de fin juin 1917 l’a été pour une faute de décembre 1915.
La 1ère partie de 1917 s'achève, ... suite à venir.














































































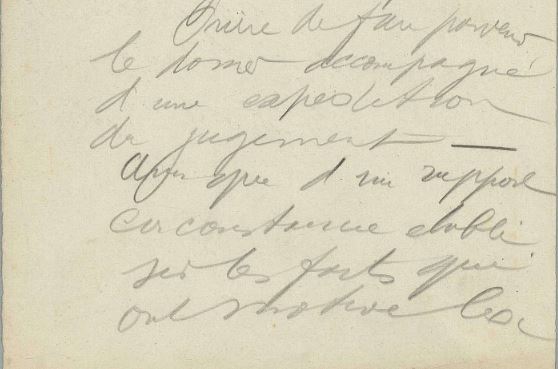






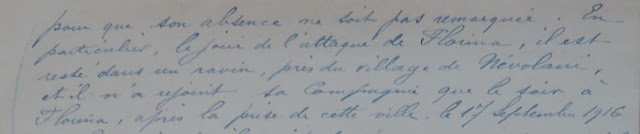















































Bonjour à toute l'équipe,
RépondreSupprimerEncore une fois un travail magnifique et des "billes " solides " pour ceux qui ont à " parler " sérieusement de cette question.
En ce qui concerne la petite première partie, versant Oriental, il me semble que l'on est dans un processus aujourd'hui classique de " maintien de l'ordre "par des militaires. Une exécution massive de 18 condamnés n'était certainement pas de nature à calmer les esprits...mais là, le terrain devient glissant.
Encore bravo et merci.
cc